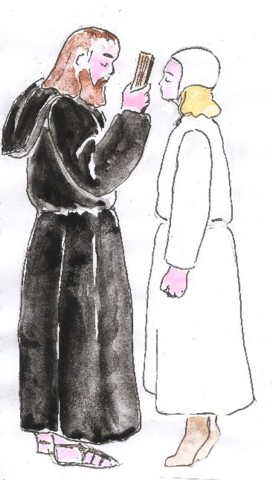EXTRAIT INÉDIT DE BENOIST SUR LES BOUGRES DU MUR-DE-BARREZ EN 1211
Dans son Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets[1], Jean Benoist produit un extrait inédit qui expose la doctrine des « hérétiques » qui sévissaient à Mur-de-Barrez du temps de la croisade des Albigeois, en 1211 précisément. Ces « hérétiques » sont nommés « Bulgares » dans le texte, il s’agit sans aucun doute possible de nos cathares, les fameux bougres. Il est curieux que cet extrait n’ait attiré l’attention de quiconque. Personne ne s’est soucié de faire des recherches sur la pièce dont parle Jean Benoist ni de tirer un quelconque profit de l’extrait produit par ce dernier.
Dans son ouvrage, aux pages 39-41, Jean Benoist explique que la comtesse d’Auberoque lui remit un « titre » daté de 1375 qu’elle avait trouvé en son château de Tinnières. À ce que je déduis des propos de Benoist, ce document contenait les pièces d’un procès qui s’était tenu sous le règne de Charles V entre Bernard, comte de Rodez, et le comte d’Auberoque. Parmi ces pièces il y avait, entre autres, des lettres de Philippe Auguste. Le motif du procès portait sur des droits que le comte d’Auberoque disait posséder à Rodez et à Mur-de-Barrez. Il attestait que les seigneurs de Tinnières étaient les descendant d’un certain Jean de Beaumont, baron de Tinnieres, et que celui-ci avait pris le parti de Simon de Monfort du temps de la croisade des Albigeois. Il avait d’ailleurs rendu « de grands services à l’Eglise dans le Païs de Roüergue ». Il avait « chassé les Bulgares de la Cité de Mur du Barroy » et avait taillé « en pieces les Albigeois, qui etoient venus pour se rendre maîtres de Rhodez ». Or, Jean Benoist repéra dans les liasses qu’il avait sous les yeux un court extrait qui se rapportait à la doctrine des « hérétiques bulgares » en question. L’extrait qu’il produit est à première vue déroutant parce que la doctrine exposée ne se retrouve pas telle quelle nous est habituellement connue mais elle ne la contredit nullement. Bien au contraire, « l’hérésie » dénoncée s’insère parfaitement dans ce que nous connaissons du catharisme. Tous les sacrements catholiques sont réfutés au motif qu’ils avaient été annulés par le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ces « hérétiques bulgares » prêchaient par ailleurs « un Dieu seulement bon et non juste ». Un témoignage capital qui conforte ce que nos modestes travaux ne cessent de démontrer. Les cathares étaient les lointains descendant de la chrétienté qui se rangea derrière Marcion de Sinope en 144.
L’Église de Marcion fut une grande Église, la première à se constituer de manière organisée. C’est elle qui est à l’origine du Nouveau Testament. Marcion avait collationné les tous premiers écrits chrétiens pour constituer un corpus assuré de l’Évangile, à savoir le récit sur Jésus et les débuts de la communauté chrétienne que Silas, un compagnon de l’apôtre Paul, avait composé ainsi que les épîtres — les courriers — que l’apôtre Paul avait adressées aux premières assemblées. Marcion opposait ainsi ce nouveau livre à la Torah pour démontrer combien l’Évangile avait été détourné par ceux qui voulaient l’insérer dans le droit fil de la tradition vétérotestamentaire. C’est le génie théologique de Marcion qui lança le slogan de son Église : le dieu de Moïse est un dieu juste et non un dieu bon. Ce sont les antithèses de Marcion, opposant l’Évangile et la Loi mosaïque, qui ont édifié ce christianisme si singulier dont nous voyons l’aboutissement chez les cathares médiévaux.
Cette chrétienté que Marcion a fédéré en Église constituée a été persécutée à mort par celle que Constantin mit au pouvoir à partir du IVe siècle. C’est d’ailleurs lui qui interdit formellement le « culte marcionite », aussi bien public que privé[2]. Au fil du temps la répression réduisit comme peau de chagrin cette chrétienté dont Justin disait en son temps, rageusement, qu’elle s’était répandue « à travers le monde »[3]. Cependant, les coups ne tardèrent pas à la faire presque entièrement disparaître. C’est par village entier, à la pointe des glaives des légionnaires, qu’on procéda à la conversion de ces chrétiens qu’on nommait marcionites. C’est ainsi que Théodoret, l’évêque de Cyr, put se glorifier d’avoir « amené à la vérité pour leur grande joie huit bourgs infestées par l’erreur de Marcion, ainsi que les régions avoisinantes »[4]. Des communautés marcionites parvinrent toutefois à se maintenir dans la clandestinité en ses foyers, là même où le christianisme était né : en Syrie, en Asie mineure et sans nul doute en Macédoine. Il faut tout de même rappeler que c’est là que l’apôtre Paul jeta toutes ses forces pour enraciner l’Évangile loin des « faux frères »[5] qui s’acharnaient à renverser les assemblées qu’il avait fondées et qui contrebattaient l’Évangile qu’il avait reçu du « Seigneur » lui-même[6]. N’oublions pas non plus qu’Aristarque le Macédonien de Thessalonique, fut le compagnon le plus dévoué de l’apôtre Paul[7]. Mais il n’était évidemment pas le seul Macédonien à entourer l’apôtre Paul, il faut encore citer Secundus[8], Gaius[9] et Sopatros[10]. Il est clair que la Macédoine fut le foyer privilégié des premiers chrétiens. C’est eux qui tinrent fermement l’Évangile prêché par l’apôtre Paul, celui-là même que Marcion revendiqua et porta aux nues. Faut-il alors s’étonner que des « hérétiques » soient mentionnés en Macédoine au Ve siècle qui se nommaient « eux-mêmes cathares, c’est-à-dire purs »[11] ? Purs au sens de vrais et bons chrétiens évidemment. Cela ne confirme-t-il pas ce que disaient les « hérétiques » entendus par Evervin quand ils disaient que leur « hérésie était demeurée cachée jusqu’à nos jours depuis le temps des martyrs et qu’elle s’était maintenue en Grèce et en d’autres terres » ? N’était-ce pas également ce que confirme Raniero Sacconi, un cathare passé au catholicisme, quand il dit dans sa Summa de Catharis que toutes les Églises cathares ont pour origine celles de Bulgarie et de Dragovitie ? Églises dont nous savons qu’elles étaient implantées en Macédoine, c’est-à-dire dans ce territoire associé à la Grèce. Il faut avoir les yeux et les tympans crevés par les aprioris et une conception totalement erronée de l’histoire et de la théologie chrétienne pour ne pas voir ce qui est éclatant et pour ne pas entendre ce qui est criant !
Maintenant venons-en à l’analyse du texte lui-même. Mais tout d’abord lisons la traduction du texte que Benoist a édité afin de se faire ses propres idées avant de lire les nôtres.
« Ils disaient que le pouvoir de Dieu le Père dura aussi longtemps que dura la Loi mosaïque parce qu’il est écrit que lorsque les choses nouvelles arriveront, les anciennes seront rejetées. Après la venue du Christ tous les sacrements de l’Ancien Testament ont pris fin et la loi nouvelle est entrée en vigueur en ce temps dont ils prêchaient ces choses-ci : À ce temps-là, donc, ils disaient que les sacrements du Nouveau Testament prenaient fin et que le temps de l’Esprit Saint était advenu, et par conséquent le Baptême, la Confession, la Pénitence, l’Eucharistie et les autres sacrements sans lesquels il n’y a pas de salut, du reste ils n’avaient plus lieu d’être, désormais chacun ne pouvait être sauvé qu’intérieurement par la grâce du Saint Esprit, sans être inspiré par un quelconque acte extérieur. Ils ont amplifié la vertu de la charité de telle manière que ce serait un autre péché si cela était fait. Dans la charité il n’y avait plus de péché, et même de luxure, et autres plaisirs qu’au nom de la charité ils accomplissaient avec les femmes avec lesquelles ils péchaient, et avec les simples qu’ils trompaient, promettant l’impunité des péchés, ils prêchaient un Dieu seulement bon et non juste ».
______________
« Ils disaient que le pouvoir de Dieu le Père dura aussi longtemps que dura la Loi mosaïque parce qu’il est écrit que lorsque les choses nouvelles arriveront, les anciennes seront rejetées »
Nous le savons bien, les cathares distinguaient très clairement le dieu néotestamentaire du dieu vétérotestamentaire. Ils identifiaient ce dernier au diable. Mais dans l’exposé des doctrines professées par les « hérétiques bulgares » cette distinction n’apparaît pas du tout. Le propos parle d’un « Dieu le père » pour désigner le dieu de l’Ancien Testament. Il n’échappera à personne que ce terme prête à confusion car c’était un terme que les cathares utilisaient couramment pour désigner le Dieu révélé par Jésus, celui que ce dernier appelait précisément père. Faut-il donc entendre que les « hérétiques » du Mur-de-Barrez considéraient que le dieu de Moïse était le dieu auquel ils croyaient ? Certes pas ! Le terme n’était pas propre aux cathares. C’était un vocable unanimement employé et son emploi n’est le fait ici que du rédacteur. C’est lui qui considérait que le dieu de la Loi, le dieu de Moïse, était Dieu le père, père, naturellement, parce qu’il était le créateur de toutes choses. Le rédacteur rapporte les doctrines des « bougres » d’après ses convictions. C’est là toute la difficulté d’un peu tout le texte si on n’a pas repéré cette subtilité. Ceci étant dégagé, la suite du propos épinglé ne pose aucune difficulté. Les « hérétiques » du Mur-de-Barrez bornent le pouvoir du dieu de la Loi à la Loi elle-même puisque, comme le dit le texte lui-même, les « choses nouvelles » ont rejetées les « anciennes ». Les choses nouvelles sont évidemment ce qu’annonce le Nouveau Testament et les choses anciennes sont tout aussi évidemment ce que l’Ancien Testament a institué. Autrement dit le pouvoir du dieu de la Loi s’est arrêté quand Jésus est descendu sur terre. C’est lui qui mit fin à la Loi. C’était là la grande conviction de l’apôtre Paul que Marcion de Sinope a défendu bec et ongle : « Christ est la fin de la Loi »[12]. C’est aussi cette destitution du dieu de la Loi, du haut de son piédestal, qui fit dire à Jésus : « j’ai vu Satan tomber du ciel comme l’éclair »[13]. Sa prédication avait foudroyé l’imposteur qui s’était révélé à Moïse et qui s’était joué de lui en lui montrant son cul. C’est en effet de dos qu’il se montra.
« Après la venue du Christ tous les sacrements de l’Ancien Testament ont pris fin et la loi nouvelle est entrée en vigueur en ce temps dont ils prêchaient ces choses-ci : À ce temps-là, donc, ils disaient que les sacrements du Nouveau Testament prenaient fin et que le temps de l’Esprit Saint était advenu, et par conséquent le Baptême, la Confession, la Pénitence, l’Eucharistie et les autres sacrements sans lesquels il n’y a pas de salut »
La suite confirme l’énoncé qui le précède : « tous les sacrements de l’Ancien Testament ont pris fin et la loi nouvelle est entrée en vigueur ». La « loi nouvelle », c’est évidemment les impératifs évangéliques : tu ne jureras pas[14], tu ne mentiras pas[15], tu ne convoiteras pas la femme que tu regarderas[16] (appel à l’abstinence sexuelle et non l’interdit de l’adultère), tu ne te coucheras pas sans avoir pardonner celui qui t’aura fait offense[17] etc., la liste est longue. Ce qui peut paraître encore une fois étonnant, c’est la suite du propos quand il est question de la suppression des « sacrements du Nouveau Testament […] sans lesquels il n’y a pas de salut », c’est-à-dire « le Baptême, la Confession, la Pénitence, l’Eucharistie et les autres sacrements ». Mais là encore, c’est le fait du rédacteur, c’est lui qui considère que les sacrements mentionnés sont utiles au salut. Les cathares avaient évidemment le point de vue diamétralement opposé. Les preuves sont là en abondance et à commencer par le texte lui-même puisqu’il annonce aussi la fin des sacrements associés au Nouveau Testament. Nous disons bien associés est nullement ceux du Nouveau Testament car c’étaient des impostures catholiques. C’est pourquoi les cathares récusaient et niaient avec force tous les sacrements que l’Église catholique jugeait utiles au salut. L’argument des « hérétiques bulgares » ici rapporté est puissant de par sa simplicité même. Comprenons-le bien : « Dieu le Père » — et là il faut se placer du point de vue des cathares eux-mêmes pour entendre la subtilité de leur propos — a mis fin aux « sacrements » juifs et aux sacrements catholiques. Précisons même un peu mieux en prenant soin d’inscrire leur proposition dans la logique de leur argument : De même que les « sacrements » de l’Ancien Testament ont pris fin avec la venue de Jésus (fait admis du catholicisme), les sacrements du Nouveau Testament (ceux que l’Église catholique disait se rattacher au Nouveau) ont pris également fins avec la venue du Saint Esprit. Autrement dit, le don du Saint Esprit supplante tout. Argument aussi imparable que percutant.
« … du reste, ils n’avaient plus lieu d’être, désormais chacun ne pouvait être sauvé qu’intérieurement par la grâce du Saint-Esprit, sans être inspiré par un quelconque acte extérieur ».
Nous l’avons vu, les sacrements, à savoir « le Baptême (celui d’eau bien entendu), la Confession, la Pénitence, l’Eucharistie » et les autres sornettes du même genre jugés « utiles au salut », pour paraphraser un peu le propos, non plus lieu d’être depuis que le Saint Esprit a été donné le jour de la Pentecôte. Le salut ne dépend plus d’un acte extérieur signifié par un tiers, c’est-à-dire les sacrements délivrés par les prêtres, mais par la seule grâce que donne le Saint Esprit quand l’homme le reçoit en lui. Nous avons là une évocation claire de la grâce qu’opère le consolamentum, le seul et unique sacrement cathare, qui infuse le Saint Esprit par imposition des mains. Là encore l’argument est très fort. Il annihile tout intérêt d’aller trouver un quelconque prêtre pour le salut de son âme. L’argument laisse clairement entendre que le baptisé d’eau, par exemple, ne pouvait point tomber sous la grâce de Dieu le Père parce que celle-ci était liée à la réception de l’Esprit Saint, c’est-à-dire au sacrement de l’imposition des mains. Là encore, manifestement, l’inspiration a été directement puisée dans ce que l’apôtre Paul avait déclaré au sujet de ceux qui demeuraient encore attachés à la Loi mosaïque : « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la Loi ; vous êtes déchus de la grâce ». Il était par conséquent facile d’appliquer le même propos à ceux qui restaient attachés à des impostures néotestamentaires. Les baptisés d’eau se séparaient du Christ et étaient exclus de la grâce tout autant que ceux qui se faisaient encore circoncire par attachement à la Loi et à son dieu, et ce en dépit du don du Saint Esprit Saint qui était descendu sur les plus fidèles disciples de Jésus le jour de la Pentecôte[18]. C’est bien ce temps-ci qui est le « temps » de la bascule dont il est question dans le propos.
« Ils ont amplifié la vertu de la charité de telle manière que ce serait un autre péché si cela était fait ».
Mieux encore que ce que nous avons vu. Aller quérir un quelconque sacrement auprès d’un quelconque prêtre pour son salut, c’est commettre un péché parce que c’est rejeter la grâce de Dieu, à savoir l’Esprit Saint. On ne peut faire plus dissuasif n’est-ce pas ? Il n’est d’ailleurs nullement impossible que ce péché évoqué soit le fameux péché contre l’Esprit si présent dans la pensée chrétienne. Ce péché mortel dont les évangiles disent qu’il ne peut être remis « en ce monde, ni dans l’autre »[19] du fait même que l’Esprit Saint est bafoué et méprisé. Or, il est patent, comme nous l’avons dit, qu’en persistant à baptiser d’eau en lieu et place de la transmission de l’Esprit Saint par imposition des mains, le Saint Esprit était bafoué et était méprisé, et de ce fait tout baptisé d’eau était exclu de la grâce de Dieu. Il était par ailleurs patent pour les cathares que le baptême d’eau était totalement inefficient. Il n’était bon qu’à laver la couenne comme le disait si bien Bélibaste. L’eau croupit et pue ajoutait-il. L’eau ne détient pas l’inaltérabilité du Saint Esprit. Il était par ailleurs patent que le baptisé d’eau ne suivait aucunement la voie étroite des impératifs évangéliques. Il ne vivait pas saintement. Il ne vivait pas selon l’Esprit de Dieu. Il n’était pas un bon homme, c’est-à-dire un bon et véritable chrétien. Il en était tout autrement pour celui qui recevait l’imposition des mains des bons et véritables chrétiens. L’efficience n’était pas que théologique chez les cathares, elle était concrètement visible. La règle de vie des chrétiens et chrétiennes cathares en témoignait. À l’inverse du baptême d’eau, l’imposition des mains n’était pas du pipeau.
« Dans la charité il n’y avait plus de péché, et même de luxure, et autres plaisirs qu’au nom de la charité ils accomplissaient avec les femmes avec lesquelles ils péchaient, et avec les simples qu’ils trompaient, promettant l’impunité des péchés ».
Que dans la charité il n’y a plus de péché, c’est là le cœur de l’enseignement de l’apôtre Paul, car c’est la Loi qui crée le péché. Le péché est en effet la désobéissance à la Loi. Or en Christ, comme le disait l’apôtre Paul, l’homme, autrement dit le chrétien, n’est plus sous la Loi mais sous la grâce du Saint Esprit. La Loi n’est plus et par conséquent les péchés qu’elle institue ne sont plus non plus. L’auteur de l’exposé a si bien compris l’argument, pur paulinisme, qu’il en a profité pour le retourner contre la libéralité prêtée aux « bougres ». Il faut bien le comprendre, les cathares, les « hérétiques bulgares » du texte, se répartissaient en deux statuts bien distincts. Il y avait d’une part les chrétiens et les chrétiennes qui étaient tenus impérativement d’observer les préceptes évangéliques, en l’occurrence la chasteté. D’autre part il y avait ceux qui n’étaient pas chrétiens mais qui appartenaient malgré tout à la communauté chrétienne en tant que catéchumènes. Ces derniers, l’Église cathare les appelait croyants parce que ce n’était pas des chrétiens. C’est la raison pour laquelle ils n’étaient pas tenus d’observer la règle de vie des bons et véritables chrétiens. Ils étaient par conséquent absolument libres d’agir à leur guise. Il est donc parfaitement vrai que ces derniers jouissaient d’une liberté totalement incompréhensible pour l’Église catholique qui, elle, entendait imposer à tous ses critères moraux. Les croyants cathares étaient d’autant plus libres qu’ils bénéficiaient d’une totale impunité de la part de leur Église. L’Église des bons et véritables chrétiens ne jugeait ni ne condamnait et contraignait moins encore. Elle disait au contraire que tous les péchés étaient absous par la réception de l’Esprit Saint. Aucune pénitence n’était nécessaire. C’est ce que l’auteur appelle tromper « les simples ». Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la confession de Géraud de Rodes, de Tarascon : « Je les ai entendus parler de la pénitence, disant que ni les prêtres ni les prélats ni les religieux ne peuvent absoudre les péchés, mais eux seuls, les hérétiques, peuvent remettre les péchés. Ils disaient en effet que quel que soit le degré où l’on soit de grands péchés, que l’on soit usurier ou meurtrier, ou dans des péchés quelconques, ils vous absoudraient sans pénitence ni compensation »[20]. Mais là où le rédacteur est malicieux c’est quand il lie la prédication cathare aux mœurs libéraux des croyants. C’est évidemment une distorsion des faits. L’accusation d’immoralité sexuelle est un poncif anti-cathare qui n’a aucune réalité. Les chrétiens et les chrétiennes cathares observaient la chasteté la plus stricte. C’étaient des saints hommes et des saintes femmes. Quant aux croyants, rien ne nous montre qu’ils aient été plus libidineux ou dépravés en la matière que les fidèles catholiques, même s’il est vrai qu’ils jouissaient d’une liberté sexuelle de fait plus grande que celle de leurs homologues catholiques. L’Église cathare ne mariait pas et ne codifiait pas plus les rapports entre homme et femme. Les catholiques étaient au contraire tenus au strict contrôle de leur Église qui allait jusqu’à codifier des plus précisément les pratiques sexuelles. Elle les conditionnait de plus à la procréation et ne les permettait bien entendu qu’à l’intérieur du mariage. Des contraintes qui trouvaient leur compensation dans le recours à la prostitution.
« … ils prêchaient un Dieu seulement bon et non juste ».
Comme nous l’avons déjà dit dans l’introduction, nous avons-là le slogan propre à Marcion de Sinope. Un slogan qui doit être explicité. Marcion disait que le dieu de Moïse était seulement juste mais non bon. Mais pourquoi précisément seulement juste et non bon ? Parce que la bonté est tout simplement hors de ce qui est juste et hors de toute justice. La bonté est littéralement hors la Loi. C’est bien pourquoi Jésus fut exécuté. Comprenons bien, le dieu de la Loi mosaïque est un juge et il juge d’après la Loi qu’il a transmise à Moïse. Or, étant donné que la désobéissance à la Loi est un péché, tout contrevenant est coupable de péchés ; et le péché, nous le savons bien, c’est la mort ; et comme tout homme contrevient d’une manière ou d’une autre à la Loi, il est coupable de mort devant son Législateur. C’est précisément pour ne pas exterminer les hommes jusqu’au dernier pour leurs menus péchés, les plus gros eux étant bel et bien sanctionnés par lapidation, pendaison ou bûcher, qu’Adonaï, l’Éternel des armées, institue les sacrifices et autres holocaustes dont l’odeur lui est si fort agréable[21]. La culpabilité des hommes est déportée sur un bouc émissaire : les malheureux animaux que l’on égorge et brûle à la place des coupables. Remarquons-le au passage, les autels sont les bouches de l’enfer ! Les sacrifices sont une abomination sans nom auquel Jésus s’opposa en prétextant que le temple ne pouvait être qu’une maison de prière et non de sacrifice et autres trafics odieux. Nous l’avons compris, puisque Adonaï juge et rétribue les hommes selon la Loi, c’est indéniablement un dieu juste. Il fait droit aux justes (les observateurs de la Loi) et condamne les injustes (les transgresseurs de la Loi). C’est donc bien un dieu juste. Il rétribue en fonction des mérites ou des fautes. Dans la Torah il déclare en effet haut et fort « rendre à l’homme selon ses œuvres et rétribuer chacun selon ses voies »[22]. Le dieu de Jésus vu par Marcion est au contraire un dieu injuste puisqu’il ne condamne pas les pécheurs et ne récompense pas les saints. Lui, comme le disait Jésus, faisait « lever son soleil sur les méchants et les bons ». Il ne rétribue pas en fonction des œuvres. Il fait grâce, totalement grâce, de toute la force de sa dilection. Autrement dit c’est un dieu bon et seulement bon. Il ne juge ni ne condamne. Il aime.
Nous l’avons suffisamment développé en introduction. Les cathares sont les descendants directs des marcionites. Bien sûr, il est toujours facile de démonter ce lien en raison de l’extrême faiblesse des sources, mais le faisceau d’indices est bien là et ne peut-être balayé d’un revers de main. Il s’agit bien pour nous d’une seule et même Église qui fut connue sous deux noms différents dans le cours de l’histoire, et même sous trois noms principaux, si nous voulons être plus précis en ajoutant celui des pauliciens. Nous attendons toujours que l’on nous propose une explication plus pertinente que la nôtre. Que l’on nous oppose des arguments contraires, nous saurons y répondre.
En tout état de cause, la doctrine qui nous est donnée ici à voir est la plus belle de celle qui nous ait été donnée d’entendre sur les cathares. Il est bien regrettable que personne n’en ait tenu cas. La simplicité de son argumentaire, la force de ses idées exprimée en quelques mots serrés, énergiques et bien liés, si on excepte les commentaires et autres points de vue du rédacteur, est un témoin inestimable du génie de la prédication cathare. Un génie qui n’avait rien à envier à celui de Marcion de Sinope. C’est toute la beauté et la grandeur de leur foi en ce dieu de parfaite dilection qui répandit son Esprit sur ceux qui le reconnurent pour père.
ANNEXE
Jean Benoist, Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, volume 1, Paris, 1691, pp. 39 – 41 :
[…]De tous les titres qui servent à prouver la vérité de cette histoire, je n’ay rien vû de plus curieux que des lettres de Philippe Auguste, rapportées dans un titre de 1375 que Madame La Contesse d’Auberoque a trouvé dans son Château de tinnieres. Cette Dame me l’ayant communiqué, j’ay reconnu qu’il étoit passé sous le Regne de Charles V Roy de France, & que le sujet fut une contestation entre Bernard Conte de Rhodez, & le Conte d’auberoque, pour des droits appartenans à ce dernier sur les villes de rodez & de Mur du Barroy. Les lettres dont ce titre fait mention sont de 1211 & portent que Jean de Beaumont Baron de Tinnieres a chassé les Bulgares de la Cité de Mur du Barroy, & garenti la ville de Rhodez contre ces heretiques […] On voit par l’acte de verification qui en a esté fait, que les Seigneurs de tinnieres descendent de ce Jean de Beaumont, qui ayant pris le parti de Simon de Monfort, rendit de grands services à l’Eglise dans le Païs de Roüergue, sur tout lors qu’il tailla en pieces les Albigeois, qui etoient venus pour se rendre maîtres de Rhodez. On y void encore quelques erreurs de ces hérétiques, que l’on a ignorées jusqu’à cette heure : j’ai mis cet acte dans les preuves, qui pour faire connoïtre que ces erreurs ont été tirées de la secte des bogomiles, dont le chef étoit un nommé Basile Medecin, & des Marcionistes, qui pour mieux établir l’impunité des peschez, prêchoient un dieu seulement bon, & non pas juste. […]
Jean Benoist, Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, volume 1, Paris, 1691, pp. 267 – 268 :
[…]Extrait de l’acte du Sieur de tinnieres passé en 1375 par lequel on découvre quelques erreurs des albigeois, que tous les Historiens n’ont point rapportées.
Dicebant quod potestas Dei Patris duravit quamdiu duravit Lex Mosaïca, & quia scriptum est quod novis supervenientibus abjicientur vetera, postquam Christus venit absoluta sunt omnia veteris Testamentis Sacramenta & viguit nova lex usque ad illud tempus quo talia paedicabant : illo ergo tempore dicebant novi Testamenti Sacramenta finem habere, & tempus sancti Spiritus advenisse, & ideo Baptismum, Confessionem, Poenitentiam, Eucharistiam, & alia sacramenta sine quibus non est salus ; de caetero non habere locum, sed unumquemque per gratiam sancti Spiritus tantum interius sine aliquo exteriori actu inspiratam posse salvari, charistatis virtutem sic ampliabant ut ide quod alias peccatum esset, si fieret : in charitate iam non esset peccatum, stupra, etiam adulteria, caetesque voluptates in charitatis nomine committebant mulieribus, cum quibus peccabant & simplicibus quos decipiebant, impunitatem pecati promittentes Deum tantummodo bonum, & non justum praedicabant.
© Ruben de Labastide – 27 août 2022, revu et corrigé le 11 juin 2024
[1]Volume 1, Paris, 1691.
[2]Eusèbe, Vita, III, LXIV.
[3]« Marcion du Pont, qui enseigne encore aujourd’hui, professe la croyance à un dieu supérieur au Créateur. Avec l’aide des démons, il sema le blasphème à travers le monde ». Apologie I, 26.
[4]Patrologia Graeca 83, 1261 c.
[5]Galates 2 : 4
[6]Cf. Galates 1 : 11-12.
[7]Voir à ce sujet Actes 19 : 29, 20 : 4, 27 : 2, Colossiens 4 : 10, Philémon 1 : 24, II Timothée 4 : 11 et Colossiens 4 : 10.
[8]Actes 20 : 4.
[9]Actes 19 : 29.
[10]Actes 20 : 4.
[11]Yves de Chartres, Prologue, Cerf, 1997, p. 95, § 31a.
[12]Romains 10 : 4.
[13]Luc 10 : 18.
[14]C.f. Matthieu 5 : 34-37.
[15]C.f. Éphésiens 4 : 25.
[16]C.f. Matthieu 5 : 28.
[17]Cf. Éphésiens 4 : 26.
[18]Actes 2 : 1-4.
[19]C.f. Matthieu 12 : 32.
[20]Ms 4269 f° 3 v°.
[21]C.f. Lévitique 4 : 31.
[22]Job 34 : 1.