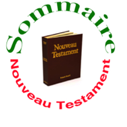Les rapports houleux de l’homme envers la religion
Read more
foi
Le croyant ne mange pas à la carte
Le croyant ne mange pas à la carte !
Présentation
Cela fait longtemps que l’on me pose les mêmes questions sur l’intérêt de la religion, sur la foi, sur la définition du croyant cathare et sur les rapports entre les religions. Cela donne parfois motif à débats enflammés et à ruptures durables.
Mais il est très difficile d’expliquer à des personnes qui n’ont pas eu l’expérience de la foi intime, ce que cela recouvre. Je prends souvent l’image de l’adolescent et de l’adulte pour tenter de l’expliquer : le premier croit savoir ce qu’est la vie d’adulte et le second sait qu’il n’en est rien, mais il n’a pas les moyens de le faire comprendre au premier.
De même, dire à quelqu’un qu’il est sympathisant quand il se pense croyant ou qu’il est croyant alors qu’il se pose des questions et doute, est un exercice difficile et peut s’avérer source de conflit.
À la façon des orateurs médiévaux et même du premier siècle, je vais utiliser le principe de la parabole pour que chacun puisse mieux visualiser ce que souhaite vous faire passer comme message.
Choisir sa table
Imaginons deux personnes désirant manger dans un restaurant un peu particulier. En effet, ce restaurant propose, comme ses confrères, de manger à la carte ou au menu. Première particularité : si vous mangez à la carte, ce sera en mélangeant des mets qui figurent sur des menus différents, et si vous choisissez un menu vous ne pourrez refuser ou modifier aucun des mets qui y figurent. La seconde particularité est que si vous mangez selon les règles d’un menu, vous occuperez une place dans la salle et à la table du menu choisi, alors que si vous choisissez la carte, vous devrez vous asseoir à une table où ne se trouvent que des personnes comme vous. Et ce, même si votre choix de mets ne diffère d’un des menus que sur un seul plat.
L’avantage de la carte, que beaucoup se voient déjà choisir, est que l’on peut manger ce que l’on veut et rejeter ce que l’on ne veut pas. De ce choix peut découler un repas nourrissant et équilibré ou, au contraire, un repas mauvais pour votre santé, c’est-à-dire pour le salut de votre intestin. L’inconvénient est que vous ne pourrez pas vous intégrer à ceux qui auront choisi un menu, même si cela correspond à vos aspirations.
L’avantage du menu est que vous êtes assuré, si vous le suivez scrupuleusement, qu’il vous apportera une alimentation saine et équilibrée tout à fait utile à votre santé. En outre, vous serez à table avec des personnes qui partagent toutes vos aspirations et vos convictions. Vous serez entouré de convives qui, bien qu’installés à d’autres tables, car leur menu diffère plus ou moins du vôtre, pourront partager avec vous sur certains points et débattre éventuellement sur des sujets où vous différez, comme le choix de certains plats, la disposition des couverts, la façon de se tenir à table, etc.
Choisir la carte ou le menu ?
Certes, nous l’avons dit, choisir la carte semble le choix le plus évident : on met dans son assiette uniquement ce qui nous convient ou nous demande le moins d’efforts et ainsi on est assuré que tout le repas se déroulera de façon assez agréable. Mais le but du repas est de manger correctement, pas de se faire plaisir. Il ne faut pas confondre les activités. Et c’est d’ailleurs le problème principal de notre époque où l’on tente de nous faire croire qu’une activité sans plaisir est mauvaise et que le plaisir est la base de nos nécessités. Il vaut mieux manger bien, quitte à consommer certains mets moins faciles à manger ou d’un goût moins agréable que d’autres et être certain de la qualité de notre alimentation, que de n’ingérer que ce qui fait plaisir et de risquer l’indigestion ou une maladie sur le long terme.
Par contre, la carte nous astreint à manger séparé de ceux dont nous pensions être proche, mais qui eux ont choisi un menu. Menu qui nous plaît aussi globalement, mais dont nous voulions rejeter certains plats qui ne nous permettent pas d’affirmer notre droit au plaisir. Cette séparation, maintenant qu’elle apparaît clairement, nous met mal à l’aise, voire nous insupporte et, au lieu de nous interroger sur les motifs de nos choix, nous considérons que la faute en revient aux autres et nous fustigeons ceux qui mangent ainsi à l’écart de nous et nous mettent le doigt sur nos différences.
Il suffirait donc de choisir le menu, mais il impose des contraintes qui peuvent nous poser problème. Déjà, chaque menu nous conduit à choisir une table spécifique et pas une autre. Certes, les menus chrétiens nous placent à des tables proches les unes des autres, car les différences peuvent être très faibles parfois : la table cathare et la table gnostique ont certes une nappe et des couverts différents, mais c’est à peu près tout, même si à la table gnostique on peut éventuellement refuser un convive s’il se prénomme Paul.
Parfois, les différences sont plus marquées. La table catholique et la table protestante se supportent, mais la table musulmane veut que tous reconnaissent que son installation est la meilleure, ce que contestent la table catholique et la table orthodoxe, sans parler de la table juive où l’on sourit en coin en pensant que ces jeunes trublions ne sont que des avatars manqués de ses propres convives.
De même, les plats peuvent fortement différer d’une table à l’autre. Ces plats sont d’ailleurs parfois l’objet de polémiques violentes : l’homosexualité est absente de presque toutes les tables, la planification des naissances, l’avortement, la PMA, le mariage des ministres du Culte, etc. Ce sont d’ailleurs souvent ces points qui ont poussé d’autres convives à choisir la carte.
Les convives
Ceux qui veulent un menu précis et qui mangent à la même table
Pour ceux-là, les choses sont claires ; ils acceptent de manger tous les plats de leur menu et ils sont en harmonie avec les autres convives de la même table. Il peut arriver qu’ils jettent parfois un œil sur les tables adjacentes ou plus éloignées et s’étonnent ou raillent les choix d’organisation de ces autres tables ou les plats de leur menu.
Mais ils savent que le respect de leur menu les conduira à un repas de qualité qui, sauf accident ou changement de cap, leur assurera le salut de leur santé future.
Ils peuvent être un peu tristes de voir au loin, dans l’autre salle, des amis qu’ils croyaient proches d’eux manger à la carte faute d’avoir pu comprendre l’intérêt du menu qu’ils ont choisi.
Pour manger ainsi il faut être au courant de ce qu’implique ce menu et l’avoir suffisamment étudié et comparé pour être certain de ne pas faire d’erreur.
Ceux qui veulent manger à la table d’un menu en le modifiant
Ces amis justement auraient bien voulu manger à leur table, mais certains plats leur semblaient trop indigestes ou trop contraignants et ils ont finalement opté pour la carte, faute de pouvoir modifier le menu. Ils sont donc insatisfaits globalement, même si leurs choix les contentent sur le moment. Ils se doutent que s’en tenir à un menu doit offrir quelque chose d’important qu’ils ne peuvent saisir et dont ils ont peur que cela leur fasse défaut à terme. Alors, soit ils sont moroses, soit ils deviennent vindicatifs. Moroses, ils vont perdre un peu du plaisir qu’ils auraient dû éprouver en consommant ces mets choisis sur mesure et ils vont profiter de toutes les occasions pour se lever de table et passer à proximité de la table réservée au menu qu’ils ont finalement refusé. Vindicatifs, ils vont exprimer haut et fort leur indépendance et critiquer ceux qui les ont rejetés, ce qui est à leurs yeux une forme de mépris et d’extrémisme.
En fait, ces convives sont tiraillés par leurs envies et refusent cependant d’être à l’écart, car l’isolement les inquiète.
Ceux qui ne veulent pas de menu et qui préfèrent la carte
Mais à leur table se trouvent des personnes qui ont délibérément choisi de ne se nourrir qu’à la carte. Tout simplement parce qu’ils considèrent que la qualité nutritionnelle des menus est une fable et que leur organisme peut supporter tout ce que leur plaisir leur commandera de manger. Que ces personnes croient à une règle nutritionnelle judicieuse sans savoir l’identifier dans les menus proposés, parce qu’ils n’ont pas encore la connaissance nécessaire, ou qu’ils ne croient à aucune règle nutritionnelle et considèrent même cette croyance comme avilissante pour le libre arbitre de chacun, chacun est là pour une bonne raison. Ils l’acceptent volontiers et s’ils regardent les tables des menus, c’est davantage pour en rire ou pour plaindre ceux qui s’imposent de telles contraintes que par envie.
Pour autant, ils choisissent dans la carte des plats qui figurent dans certains menus, ce qui amoindrit un peu leur sensation d’indépendance.
La qualité du repas
Exprimer un point de vue sur la qualité du repas est un exercice difficile. En effet, ayant fait le choix d’un menu, j’ai logiquement tendance à être convaincu de l’importance de la qualité du repas et de préférer le mien à celui des autres.
Essayons néanmoins d’être pragmatiques dans notre réflexion.
De deux choses l’une : soit la qualité des repas n’aura aucune incidence sur l’état futur de notre santé et pour le salut de notre bien-être, soit il est essentiel d’avoir des repas équilibrés et de qualité pour espérer sauver notre peau.
Dans le premier cas de figure, où l’on s’installe et quoi que l’on mange, notre santé n’a pas à en souffrir. Du coup, ceux qui mangent à la carte n’ont rien à redouter et les menus non plus en fait. Certes, les cartes vont se moquer de leurs efforts et contraintes finalement inutiles. Mais ce qui compte c’est d’être en bonne santé.
Dans le second cas de figure, ceux qui mangent à la carte vont au-devant de gros ennuis et quand ils finiront par s’en rendre compte et par l’admettre, ils devront suivre un traitement et un régime draconiens pour espérer rejoindre l’état de santé des autres ; s’il est encore temps de la faire. Ceux qui auront choisi un menu, pour autant que le cœur du menu — c’est-à-dire l’équilibre alimentaire — y soit respecté, auront de bien meilleures chances d’être en bonne santé et de se sauver.
Cela correspond à la discussion que je peux avoir avec des personnes qui ne comprennent pas mes choix spirituels et qui voudraient les moquer, mais craignent mes arguments. Pour ma part, je me contente de leur expliquer que mes choix sont strictement pragmatiques. En effet, ayant choisi la voie que m’indique ma foi et le comportement qu’approuve ma morale, je n’ai que deux issues possibles :
- soit je me trompe et il n’y a rien après la mort, auquel cas je n’aurais rien perdu puisque j’aurais vécu en accord avec mon point de vue ;
- soit il y a bien un au-delà de la mort, auquel cas je serai satisfait d’avoir suivi ma voie.
Pour mon interlocuteur qui fait le choix de ne pas avoir la foi, il y aussi deux hypothèses :
- soit il n’y a rien après la mort et il n’aura rien perdu non plus ;
- soit si son comportement n’a visé qu’à satisfaire ses pulsions et qu’il y a un au-delà, il court le risque d’en supporter les conséquences.
Au final, je me trouve plutôt bien avisé d’agir comme je le fais, surtout que ce qui est vécu comme une contrainte par les autres n’en est pas une pour moi.
Conclusion
Comme dans toute parabole, il convient de proposer une courte analyse afin d’expliquer clairement les choses à celles et ceux qui hésiteraient encore sur l’interprétation à donner à ce texte.
Quand on est croyant, on accepte la doctrine de sa foi sans réserve. Si l’on veut commencer par arranger le menu à sa guise on n’est plus croyant, mais au mieux sympathisant.
Le croyant ne mange pas à la carte !
Certes, beaucoup de personnes, qui ont perdu le sens de ce que croyant veut dire, se pensent croyantes et laissent leur mondanité et leur sensualité dicter des choix qui, de fait, les remettent hors de la foi à laquelle elles prétendent appartenir. On voit notamment cela dans le catholicisme où les croyants critiquent le célibat des prêtres, le rejet de la contraception et de l’avortement, la PMA et que sais-je encore. Il est tout à fait légitime d’être choqué par certains choix de l’Église catholique ; la seule voie honnête est alors de s’en séparer au lieu de vouloir imposer ses choix.
Concernant le catharisme, c’est la même chose. Nous avons maintenant une idée précise de ce qu’est la doctrine cathare. Soit on la fait sienne et l’on est croyant, soit on voudrait en modifier certains points et on n’est, au mieux que sympathisant.
Enfin, cessons de nous focaliser sur des points secondaires. L’habitude du judéo-christianisme est de nous faire croire que tout est doctrine. C’est faux ! La doctrine est l’ensemble des points qui définissent l’attitude du croyant en vue de son salut. La cosmogonie n’est pas doctrine ; c’est tout au mieux une tentative de compréhension ou d’explication fortement limitée par les capacités de notre cerveau mondain à se projeter dans un espace qui lui sera à tout jamais totalement étranger et inaccessible.
Cependant, la cosmogonie ne peut s’opposer à certains éléments doctrinaux fondamentaux, sous peine de nullité de la doctrine et, par nécessité, de la religion elle-même. Selon les religions concernées, peu importe que l’on pense que Dieu est créateur de l’univers ou pas, que Jésus a vécu en homme ou pas, que Marie fut vierge et mère ou pas. Ce qui compte, c’est que l’on suive la doctrine de façon à pouvoir accéder au salut. Et si l’on ne peut se fixer sur une foi, cette doctrine qui est généralement à peu près la même dans toutes les religions, peut s’appliquer globalement hors de la religion et elle devient alors une morale de vie, ce qui permet à un athée de vivre aussi bien qu’un croyant.
Pour le catharisme, la cosmologie ne peut faire de Dieu le créateur d’un monde imparfait ou de Jésus un être humain volontairement déchu de son état spirituel. Mais outre le minimum cosmologique cohérent avec la doctrine, ce que le catharisme nous rappelle, comme le faisait la philosophie grecque, c’est que la doctrine seule est insuffisante ; il faut vivre au quotidien en accord avec sa doctrine si l’on veut avancer sur deux jambes et non boiter bas.
Fort de cette réflexion, je vous invite à vous interroger sereinement et en toute conscience, puis à vous comporter en accord avec le résultat de votre propre réflexion.
Guilhem de Carcassonne.
Comment se sont créés les évangiles ?
Comment se sont créés les évangiles ?
Initialement, la prédication des apôtres se faisait de manière strictement orale. Ils avaient toute latitude pour se déplacer et enseigner à travers tout le pays sans rien d’autre à craindre que le sanhedrin, le tribunal juif, qui veillait à l’orthodoxie et qui luttait contre le blasphème.
Mais un événement terrible va venir perturber cela. La guerre des juifs, comme l’a appelée Flavius Josèphe, va aboutir à la chute et à la destruction du temple de Jérusalem, ainsi qu’au massacre de milliers de juifs. Une terrible répression va ensuite se mettre en place pour de nombreuses années. Cela eut deux conséquences : le juifs ne pouvait plus se rendre au temple qui était le centre de leurs cultes, et les prédicateurs avaient beaucoup de mal à transmettre la tradition orale, avec le risque de la voir se disloquer dans son contenu en raison des difficultés de communication entre les centre de prêche.
Les juifs vont s’adapter en transférant le centre religieux qu’était le temple dans les synagogues, ce que l’on appelle la diaspora et les futurs chrétiens vont mettre par écrit leur tradition orale.
Pourtant un cas d’espèce particulier existait depuis 50 environ ; c’était Paul. De part son érudition personnelle d’une part, et en raison de la nature éparpillée de son auditoire d’autre part, il avait utilisé l’écrit en appui de sa prédication orale pour préparer les foules avant sa venue et pour renforcer sa prédication quand il partait pour de longs mois et même plusieurs années.
C’est pour cela que les écrits pauliniens sont largement antérieurs à tous les écrits judéo-chrétiens. Les évangiles synoptiques sont le reflet de cette mise par écrit d’une tradition orale. Comme le fit beaucoup plus récemment Tolkien, ce qui fut mis par écrit était une histoire parlée que l’on voulait conserver dans une certaine unité. L’auteur de Bilbo le hobbit le fit pour enrichir son récit qu’il racontait à ses enfants, les prédicateurs judéo-chrétiens le faisaient pour conserver une relative cohérence à leurs prêches. Cela explique également les convergences entre les textes et les corrections apportées pendant près de trois siècles.
À la fin du premier siècle, d’autres écrits furent produits et cela dura encore jusqu’à la mise en forme du Nouveau Testament.
Mais ces textes, qui n’avaient connu aucune tradition orale préalable, s’adressaient à des personnes averties. Ainsi l’Évangile selon Jean comportait de nombreuses idées philosophiques et des remises en cause de la tradition juive qui n’auraient jamais pu exister 50 ans plus tôt. Même Paul était beaucoup plus modéré et cela lui a pourtant valu plusieurs menaces de mort. Au deuxième siècle, ces écrits se sont multipliés, notamment en raison de la prise de pouvoir du judéo-christianisme des prédicateurs de Jérusalem qui rejetaient les autres courants pagano-chrétiens, dans l’appellation de gnostiques, de façon à les différencier et de les dénigrer.
Ces écrits, sans tradition orale, avaient besoin de toucher un public plus érudit et devaient donc aller plus loin dans la sollicitation intellectuelle. C’est pour cela qu’ils prirent une forme plus ésotérique et une présentation moins narrative. L’Évangile selon Thomas est de cette veine.
Est-ce que l’évangile attribué à Jean est de la main d’Apollos et celui attribué à Thomas de celle de Valentin ? Je pense que les experts continueront d’en discuter dans plusieurs siècles. Mais il est vrai que la forme de ces textes correspond bien aux étapes que je viens de décrire.
Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de la validation par l’antériorité. Ce n’est pas parce qu’un texte est plus ancien qu’un autre qu’il est plus authentique et plus valable. Paul qui n’a jamais connu celui que nous appelons Jésus et qui n’a même pas cherché à connaître ceux qui prétendaient l’avoir connu vivant, a écrit sur la base de l’inspiration reçue de christ. Et en matière de foi, c’est cela qui importe.
Chacun de nous est libre de suivre telle ou telle foi, mais en matière de recherche il ne faut fermer aucune porte et explorer toutes les pistes, même celles qui ne vont pas dans le sens de notre foi.
Éric Delmas, 20 novembre 2019.
Définir le Catharisme d’aujourd’hui
Définir le catharisme d’aujourd’hui
Qu’est-ce que le catharisme ?
Cette question peut en surprendre plus d’un, émanant d’une personne qui mène des recherches approfondies sur le sujet depuis douze ans et qui vit depuis deux ans et demi comme un novice cathare.Read more
Réussir sans efforts
Réussir sans effort
Le monde du virtuel
Notre monde est sans cesse mû par un désir de fuite en avant, persuadé qu’il est qu’il faut tout vivre tout de suite et que la patience est une perte de temps. Read more
Lettre de Paul aux Hébreux – 11
Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.
Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.
Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.
Lettre aux Hébreux
Chapitre 11
1 – La foi est la substance de ce qu’on espère, la preuve de ce qu’on ne voit pas.
2 – Elle valut en effet aux anciens le témoignage qu’ils ont reçu.
Mon analyse :
Ce chapitre va nous montrer à travers la Genèse et l’Exode que la foi fut au centre des préoccupations de ceux qui ont fait le Judaïsme.
3 – Par la foi, nous comprenons que les siècles sont produits par la parole de Dieu de sorte que ce qui se voit ne vient pas de ce qui paraît.
4 – Par la foi, Abel a offert à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn et, à cause d’elle, il fut proclamé juste, Dieu lui-même attestant ses offrandes. À cause d’elle aussi, bien que mort, il parle encore.
5 – Par la foi, Hénoch fut transféré pour ne pas voir la mort et ne fut plus trouvé parce que Dieu l’avait transféré. Avant son transfert en effet, on avait attesté qu’il était au gré de Dieu.
6 – Or, sans foi, impossible d’être agréé. Pour approcher de Dieu, on doit croire qu’il est et qu’il paiera ceux qui le cherchent.
7 – Par la foi, Noé, averti de ce qui ne se voyait pas encore, craignit Dieu et, pour sauver sa maison, construisit l’arche par laquelle il condamnait le monde et héritait de la justice qui vient de la foi.
8 – Pair la foi, Abraham obéit à l’appel et partit pour le lieu dont il allait hériter. Il partit sans savoir où il allait.
9 – Par la foi, il séjourna en terre promise comme dans une terre étrangère et habita dans des abris avec Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse.
10 – Il attendait en effet la ville qui a des fondations et dont Dieu est l’architecte et le bâtisseur.
11 – Par la foi aussi, Sara eut pouvoir d’enfanter malgré son grand âge parce qu’elle estima fidèle celui qui promettait.
12 – C’est pourquoi, d’un seul homme, qui était comme déjà mort, sont nés des hommes aussi nombreux que les étoiles du ciel, innombrables autant que le sable des rivages marins.
Mon analyse :
Tout d’abord c’est d’Abel à Abraham qu’est illustrée la puissance de la foi. Abel représente le peuple Hébreu alors que Caïn représente le peuple des plaines, les Cananéens. Adam est oublié puisqu’il a péché contre Dieu.
13 – Ils sont tous morts dans la foi sans avoir bénéficié des promesses, mais ils les ont vues et saluées de loin et ont avoué qu’ils étaient des étrangers et des passants sur la terre.
14 – Or ceux qui parlent ainsi montrent bien qu’ils cherchent une patrie.
15 – Et s’ils songeaient à celle d’où ils venaient, ils avaient le temps d’y retourner,
16 – mais voilà, ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte de s’appeler leur Dieu. Il leur a en effet préparé une ville.
Mon analyse :
L’auteur nous montre que ces personnages étaient conscient que rien en ce monde ne pouvait leur convenir et que leur patrie était céleste, comme celle qui descendra dans l’Apocalypse.
17 – Par la foi, Abraham, mis à l’épreuve, a offert Isaac. Ayant reçu les promesses, il offrit son fils unique
18 – dont on lui avait dit : C’est par Isaac que tu auras une semence de ton nom.
19 – Mais il compta que Dieu pouvait même le relever d’entre les morts. De là qu’il le recouvra et ce fut une parabole.
20 – Par la foi aussi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l’avenir.
21 – Par la foi, Jacob mourant bénit chaque fils de Joseph et se prosterna sur le bout de son bâton.
22 – Par la foi, Joseph, à sa fin, mentionna l’exode des fils d’Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements.
23 – Par la foi, les parents de Moïse, à sa naissance, le cachèrent trois mois parce qu’ils virent que l’enfant était agréable et ils ne craignirent pas l’ordre du roi.
24 – Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça à passer pour fils de la fille de Pharaon ;
25 – il préféra le malheur du peuple de Dieu au plaisir temporaire du péché
26 – et estima plus l’opprobre du Christ que la richesse des trésors d’Égypte, car il regardait le paiement.
27 – Par la foi, il quitta l’Égypte sans craindre la fureur du roi, car il était ferme comme s’il voyait l’invisible.
28 – Par la foi, il fit la pâque et l’aspersion du sang pour que l’exterminateur ne touchât plus aux premiers-nés.
29 – Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, mais les Égyptiens qui s’y risquèrent furent engloutis.
30 – Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent quand on en eut fait le tour sept jours.
31 – Par la foi, la prostituée Rahab, ayant accueilli pacifiquement les espions, ne périt pas avec les indociles.
Mon analyse :
Si Abraham agit, y compris de façon paradoxale, en vue de la promesse d’une descendance, Isaac le sacrifié est lui le symbole de la promesse eschatologique : Si tu sacrifie ce que tu as de plus important, je t’en donnerai plus encore. Moïse illustre le renoncement aux promesses et au bonheur terrestre en vue d’un plus grand que fait pressentir la foi. Enfin, les événements sont cités sans explication jusqu’à la conquête de la terre d’Israël.
32 – Que dire encore ? car le temps me manquerait si je parlais de Gédéon, de Barac, de Samson, de Jephté, de David et de Samuel et des prophètes.
33 – Par la foi, ils conquirent des royaumes, pratiquèrent la justice, obtinrent l’accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions,
34 – éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant du sabre, surmontèrent leur faiblesse, furent vaillants à la guerre, repoussèrent l’assaut de l’étranger.
35 – Des femmes reçurent leurs morts ressuscités. Des torturés refusèrent la délivrance pour obtenir une résurrection meilleure.
36 – D’autres furent éprouvés de moqueries et de fouets ou de chaînes et de prison,
37 – furent lapidés, tourmentés, sciés, moururent sous le sabre, vagabondèrent en peau de mouton, en peau de chèvre, indigents, affligés, maltraités,
38 – eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts, dans les montagnes, dans les antres et les trous de la terre.
Mon analyse :
Enfin, c’est dans les Rois, les Juges et les Prophètes que nous sont proposés des exemples de foi invincible malgré les événements. D’abord ceux qui par la fois réussirent leur mission, puis ceux qui supportèrent la mort, les supplices et la captivité plutôt que de perdre la foi.
39 – Et tous reçurent témoignage de leur foi mais sans bénéficier de la promesse,
40 – car Dieu qui nous réservait mieux ne les a pas voulu parfaits sans nous.
Mon analyse :
La rupture avec le Judaïsme est notée dans le fait que la promesse faite autrefois n’est pas valable, puisque tous n’en ont pas bénéficié, mais surtout parce que aujourd’hui il y a mieux que la promesse, c’est-à-dire le salut assuré par Christ.
Lettre de Paul aux Hébreux – 6
Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.
Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.
Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.
Lettre aux Hébreux
Chapitre 6
Lettre de Paul à Tite – 3
Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.
Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.
Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.
Lettre à Tite
Chapitre 3
Lettre de Paul à Tite – 1
Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.
Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.
Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.
Lettre à Tite
Chapitre 1
Deuxième lettre de Paul à Timothée – 1
Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.
Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.
Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.