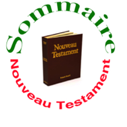Où est Dieu ?
J’ai conscience du caractère iconoclaste de cette remarque. Pourtant je ne peux m’empêcher de me la poser quand je vois combien ce monde semble fonctionner sur le concept de l’élimination de Dieu. En effet, le mal est omniprésent et le monde souffre de nombreuses imperfections sans que l’on puisse dire clairement qui est responsable de cette situation.
Pourtant il est courant d’entendre les rescapés d’une catastrophe humaine ou naturelle remercier Dieu de les avoir épargnés. Faut-il en conclure qu’ils pensent que ce dernier est responsable de l’événement, ou seulement de leur salut ? Et que dire des religions qui font de Dieu le facteur (créateur) du monde au sens large tout en le considérant comme absolument parfait ?
Qui est Dieu ?
Le point de vue cathare
Nous avons déjà tenté d’apporter des éléments de réponse à cette question. Un croyant définit Dieu comme une « entité » spirituelle omnisciente, omnipotente et bonne.
D’un point de vue cathare, les choses sont encore plus définies. Dieu est le principe du Bien, c’est-à-dire à l’origine du Bien absolu, inaltérable et éternel. Il dispose de l’Être ce qui l’élève au-dessus du simple état principiel et en fait le seul et unique vrai Dieu.
Qu’en pensent les autres ?
Les judéo-chrétiens en font le créateur du ciel et de la terre et ils considèrent qu’il nous a créés à son image. Cela interroge. Comment un être totalement tourné vers le Bien, omnipotent et omniscient peut-il être à l’origine de créations imparfaites, indifférentes aux maux qu’elles causent, voire volontairement tournées vers le mal ? La réponse de ces courants religieux chrétiens est que le mal est dû au péché originel. Mais comment expliquer le mal antérieur à l’homme ? Plusieurs extinctions massives des espèces vivantes se sont produites avant même que l’homme n’apparaisse sur terre. La dernière et plus connue a provoqué la disparition des dinosaures voici 65 millions d’années. Le péché originel ne saurait être incriminé. C’est bien le caractère chaotique et imprévisible de la création de ce monde qui favorise et provoque des cataclysmes responsables de ces catastrophes dont rien ne nous dit que la prochaine pourrait être à l’origine de notre propre disparition.
Les hommes sont capables du pire comme du meilleur et l’actualité récente nous le confirme malheureusement de façon claire et indiscutable. Comment imaginer que Dieu ait pu nous créer à son image ? Ou alors ces religions, auxquelles nous pouvons ajouter l’islam et le judaïsme, considèrent que Dieu serait comme nous capable du pire comme du meilleur, ce qui invalide totalement l’idée princeps que l’on se fait de lui. Il ne serait plus la référence absolue du Bien inaltérable et éternel comme cela était mis en avant dans les religions polythéistes qui faisaient des dieux des entités supérieures certes, mais dotées des mêmes qualités et défauts que l’humanité. Il va sans dire que les cathares s’opposent fermement à cette idée, ce qui explique qu’ils aient énoncé la réalité d’un principe du Mal, dépourvu d’Être et seul responsable du mal dans une création imparfaite et corruptible dont il est le seul auteur.
Pourquoi le mal ?
Si certains philosophent sur le fait que le mal est indispensable au bien, on est droit de chercher un peu plus loin. Un ami philosophe, Yves Maris, disait avec une pointe d’humour que « Le mal c’est ce qui fait mal ». Certes, mais cela ne nous fait guère avancer.
Pour sortir des schémas anthropocentriques et géocentriques, voyons comment analyser le mal. Il y a le mal qui ne doit rien à l’humanité, comme la chute d’un corps céleste ou une éruption volcanique et le mal que l’on peut attribuer à l’homme, comme les violences individuelles et collectives ou le dérèglement climatique. Mais dans le cas des maux que l’on impute à l’homme, nous pouvons rétorquer que si l’homme est à l’image de Dieu, c’est ce dernier qui doit porter la responsabilité de ses actions.
En fait, la question qui se pose est de savoir si le mal est inéluctable et indispensable à l’univers. Sans la violence du big bang et ses conséquences sur les matières et les gaz qu’il a libéré, jamais les étoiles et les planètes n’auraient pu apparaître et s’organiser en galaxies. La violence de la nature modèle la terre et sélectionne les espèces pour favoriser les plus aptes et pour terraformer notre monde qui est devenu humainement vivable grâce à ces bouleversements. Il est donc raisonnable de considérer que le mal est indispensable à la création et, d’une certaine façon, qu’il lui est même consubstantiel.
C’est d’ailleurs ce que pensent les cathares. Mais au lieu de faire le grand écart en l’attribuant, directement ou non, à Dieu, ils ont eu la cohérence et la logique de considérer que cet univers était la création du démiurge, Deus ex machina du principe du Mal.
Alors, si l’univers est la création du Mal, la question qui se pose est de savoir où est Dieu ?
Dieu est un anachronisme en ce monde
Quelle est la part divine ici-bas ?
En fait, cette question est strictement humaine. Car à un moment de leur évolution, les espèces homo néandethalensis, naledi et sapiens, nos ancêtres du point de vue phylogénétique, se sont mises à rechercher une transcendance hors du monde au lieu de la vénérer dans les objets et les phénomènes climatiques. Ce changement psychologique, même s’il obéissait aussi à des impératifs mimétiques, liés au regroupement des cellules familiales nucléaires du paléolithique, signe une modification sélective et profonde d’espèces pourtant déjà installées depuis longtemps.
Pour les cathares, cet instant signerait possiblement l’infusion d’une part de l’Esprit unique — émanation divine — créant de fait un composé humain comportant, d’une part un corps et un système d’organisation appelé âme humaine et, d’autre part une parcelle spirituelle issue sans être séparée de l’Esprit unique que j’appelle l’esprit-saint pour ne pas le confondre avec le saint Esprit consolateur. C’est cette infusion qui a donné à ces animaux terrestres des capacités nouvelles qui leur a profité sur le plan intellectuel et organisationnel, même si sur le plan pratique, elle leur a plutôt compliqué la vie, contrairement aux autres « inventions » précédentes comme la bipédie et la taille des silex. On retrouve cette idée dans un film de science-fiction : 2001, l’Odyssée de l’espace où l’on voit un groupe de singes, en compétition plutôt défavorables avec leurs congénères, découvrir un monolithe noir et lisse de forme parallélépipédique dont le simple contact favorise leur évolution intellectuelle.
Si c’est cette infusion spirituelle qui a fait de nous ce composé humain, à la fois issu du mauvais et du principe du Bien, c’est que Dieu n’est pas impliqué dans ce monde ni même dans ce qui fait ce principe malin. Comme le disent les cathares et leurs prédécesseurs, Dieu est étranger et inconnu dans ce monde. Cela explique que les hommes échouent systématiquement à imaginer que Dieu puisse avoir quelque responsabilité dans l’existence du mal.
À la recherche de Dieu
Si les hommes sont sans cesse à la recherche d’un Dieu perceptible c’est sans doute parce qu’ils ont conscience qu’ils sont issus d’un ailleurs indéfinissable où Dieu serait la référence unique. Comme le disait le poète : « L’homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux ». Cela pourrait expliquer que nous soyons si fortement attirés par l’hypothèse d’une vie extraterrestre, sous la forme d’êtres qui seraient à l’origine de notre création ou qu’ils seraient débarrassés de nos tares congénitales et que leur sagesse pacifique les aurait portés à un niveau de savoir tel qu’ils viendraient à nous pour en partager une partie. Mais, notre nature étant ce qu’elle est, nous imaginons aussi qu’ils puissent être désireux de nous éliminer pour profiter des produits de notre planète ou qu’ils se soient fait passer pour Dieu afin de nous manipuler comme cela est proposé dans le film Stargate, la porte des étoiles.
Mais nous commettons l’erreur géocentrique la plus commune qui est d’imaginer que l’univers où nous vivons et celui où est Dieu sont séparés d’un point de vue dimensionnel. En fait, comme essaie de le rendre le film de science-fiction, Interstellar, nous devons considérer que l’empyrée divin n’est pas soumis aux dimensions que nous connaissons et qu’il est à la fois autour de nous et en nous, puisque la parcelle d’Esprit unique qui donne à notre corps-prison l’illusion de la durée, reste indissolublement rattachée à son origine.
Dieu n’est donc ni dans, ni hors du monde : il est ailleurs.
Le bien et le mal sont étrangers à Dieu
Une fois posée cette hypothèse, nous devons nous demander si malgré son « éloignement » Dieu peut avoir une influence sur ce monde. La réalité est claire ; Dieu ne peut agir contre le Mal pour la bonne raison que le principe du Bien et celui du Mal sont tous les deux totalement étrangers l’un à l’autre et ne peuvent agir dans la sphère d’influence de l’autre, car ils sont dépourvus de ce qui est l’essence de l’autre principe. Dieu n’a pas de mal à opposer au Mal et le Mal ne peut interférer sur la part divine qui est prisonnière ici-bas.
Dans ce monde, le bien et le mal sont toujours relatifs. Un mal peut déboucher sur du positif (un accouchement par exemple) et un bien peut déboucher sur du négatif (gagner au Loto® par exemple). Or Dieu n’est pas relatif, il est absolu ; il est donc étranger au mal dans ce monde et même au bien relatif. Cependant, il faut introduire une nuance à mon propos démoralisant. La parcelle divine qui est notre fonds réel, même enfermée dans cette enveloppe de chair et soumise aux agissements de l’âme mondaine qui cherchent à l’empêcher de revenir à Dieu, peut s’exprimer quand elle parvient à supplanter ces contraintes. Cela peut être exceptionnel ou plus régulier.
Les cathares appellent cela l’éveil, c’est-à-dire le moment où nous découvrons la réalité de notre situation mondaine et où nous décidons de changer de paradigmes, comme lorsque le héros du film Matrix, choisit la gélule rouge qui ouvre sur la vérité de son état au lieu de la pilule bleue qui lui procure un confort relatif au sein de la matrice.
Quand un être humain, cathare ou non, spirituel ou non, décide d’agir en accord avec son intime conviction d’être étranger au mal, il peut produire des choix qui produisent du bien sans provoquer en contrepartie le moindre mal. Cela est rare, mais pas exceptionnel.
Donc, quand nous voyons un bien relatif émerger d’un mal absolu, comme lors d’une catastrophe humaine ou liée à la nature, cessons de louer Dieu des vies sauvées en oubliant les vies perdues, et tentons de nous élever au-dessus des considérations bassement mondaines pour étudier les causes et les aboutissants de ce qui nous entoure. C’est par le savoir que nous pouvons accéder à un niveau de compréhension suffisant pour titiller notre part spirituelle et favoriser l’éveil. Cela ne peut venir que de nous. Alors nous saurons où est Dieu.
Guilhem de Carcassonne, le 05 novembre 2023.


 Qui est Dieu ?
Qui est Dieu ?