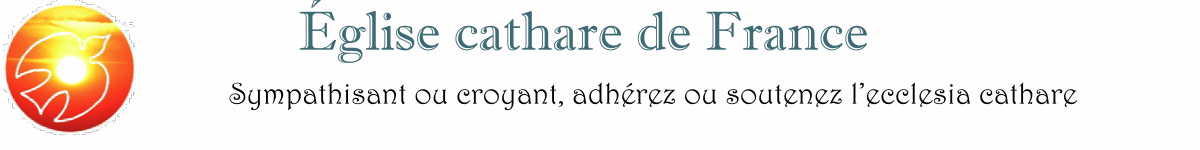La légende de l’herbe bleue ou le conte du roi des corbeaux.
Ce conte de Gascogne recueilli par J.-F. Bladé est un conte initiatique, intemporel, poétique et mystique qui relate l’histoire d’une rédemption, mais aussi une quête de la lumière qui soustraira l’âme errante au néant.
Dans la classification des contes de Aarne Thompson[1] « Le roi des corbeaux » est représentatif du type 425 : la recherche de l’époux disparu, que l’on retrouve de l’Europe à la Chine et qui a été développé par Apulée[2] dans les « Métamorphoses » sous le titre d’« Amour et Psyché ». Mais « Le roi des corbeaux » est aussi représentatif du type 471 : le voyage dans l’Autre Monde .
Les personnages
Le père : créature hybride, homme vert et cyclope, nous emporte dès le début dans le monde de l’imaginaire, mais un imaginaire rassurant car familier : cet homme vert réside au bord du bois de Ramier, entre Lectoure et Fleurance, forêt évidemment connue des auditeurs.
Ses trois filles, l’aînée belle comme le jour, la cadette plus belle que l’aînée, et la dernière plus belle que la cadette ne sont pas, bien sûr, sans nous rappeler les trois sœurs de « La Belle et la Bête ». L’aînée et la cadette exprimaient dans ce conte la même aversion pour le mari proposé que le font ici les sœurs de notre héroïne.
L’héroïne : c’est encore une fois, la plus jeune (encore une enfant) qui fait le sacrifice de sa personne en acceptant le mariage contre nature et donc monstrueux avec un animal (cf. « Conte languedocien du Serpent », « La Belle et la Bête ». Alors que son père lui-même refuse de livrer son enfant au corbeau, par peur de la damnation, la jeune fille accepte sans arrière-pensée. Devenue reine, elle commence alors sa quête dans ce merveilleux château de solitude propice à l’introspection. Elle fait bien plus, bien sûr, qu’accepter son sort ; elle le choisit, avec courage et naïveté, et ce sont ses qualités ; sa détermination, sa générosité et sa pureté qui vont lui permettre d’avancer sur son chemin. A l’instar de l’héroïne du conte « Les fées », elle se montre toujours prête à aider les autres, douée d’empathie et de générosité. En tant que reine, elle reste humble en proposant son aide à la vieille lavandière, et sa pureté apparaît alors aussitôt dans la puissance de son geste : « La reine n’eut pas plus tôt plongé le linge dans l’eau, qu’il devint blanc comme lait ». Elle traverse l’épreuve dans la simplicité et s’en trouve grandie.
Le Mal est ici personnifié par un ennemi redoutable, le « méchant gueux » qui changea le roi (époux de l’héroïne) et tout son peuple en corbeaux. Il nous rappelle, bien sûr, un autre « gueux », Cagolouisdors, « plus méchant que cent diables, qui a grand pouvoir sur terre » et qui transforma le promis en pou.
Le Bien, incarné par la lavandière, se présente comme une aide précieuse mais limitée. Elle aidera bien sûr notre héroïne mais, comme nous l’avons vu dans le conte de « L’homme voilé », cette dernière devra faire ses preuves sur son chemin de purification, nous rappelant ainsi le long et solitaire chemin du croyant pour parvenir à sa bonne fin. La lavandière « ridée comme un vieux cuir et vieille comme un chemin […] chantait en tordant un linge noir comme la suie ». Sa chanson énigmatique sonne comme une prophétie : « Tu n’as pas achevé de souffrir. Ton mari t’a donné de bons conseils. Mais les conseils ne servent à rien, et ce qui doit arriver ne manque jamais. Maintenant passe ton chemin, et ne retourne ici que dans un jour de grand besoin ». Ces paroles nous suggèrent que lors de notre quête spirituelle, personne ne peut s’acquitter de notre tâche à notre place, seule des aides ponctuelles peuvent nous éclairer dans l’obscurité du chemin personnel. Telle une bonne fée, la lavandière va faire don de trois objets magiques à la reine, objets symboles à la fois des vertus possibles qui peuvent naître de l’âme et du labeur nécessaire pour acquérir ces vertus : la paire de souliers de fer, probablement instrument de torture pour avancer, ne marquera la fin du chemin que lorsqu’elle sera usée, la besace toujours pleine de nourriture, et la gourde qui fournira la boisson à volonté sont elles, de véritables aides qui lui permettront de se consacrer à sa quête sans se soucier des contingences matérielles, nous rappelant la parole de Christ (Luc 12.22 : « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi le vêtir. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ». Le couteau en or, enfin, objet magique censé couper l’herbe bleue, sera aussi regrettablement l’outil du meurtre des loups. C’est donc cette seule arme détenue par notre héroïne qui fera d’elle une violente.
L’époux, personnage métamorphosé (ainsi que tout son peuple) par un être malfaisant ne pourra être libéré du maléfice que par la réussite des épreuves dévolues à son épouse.
Les loups, gardiens de l’époux prisonnier, encore une fois associés au mal, sont néanmoins ici une pâle copie de la sauvagerie du vautour dévorant le foie de Prométhée.
La métamorphose
La métamorphose selon laquelle les dieux ou les êtres humains peuvent se transformer ou être transformés en un autre animal, de façon complète ou partielle est présente, nous rappelle J. E. Merceron[3], depuis l’Antiquité dans de nombreuses mythologies et religions. C’est, dit-il, une donnée fondamentale des sociétés polythéistes, grecque, romaine et celte. Dans la mythologie celte, dans les récits épiques, les guerriers se transforment souvent en corbeau, tel Lug, le fils de Cian. La métamorphose peut être volontaire (chez les dieux) ou subie, trompeuse ou protectrice, réversible ou irréversible.
Selon G. S. Nourry-Namur[4] nous devons nous rappeler enfin, que « transformer » signifie changer de forme, mais pas forcément d’essence.
Le corbeau, nous dit-on, symbolise les longues épreuves, le travail de préparation effectué « en aveugle », échelonné sur plus d’une année, au terme de laquelle survient la « libération ». Cette définition correspond tout-à-fait à notre conte.
Le mariage
Seul, cet acte de sacrifice de la part de la Belle peut libérer la Bête, tout comme dans le conte bien connu. Le don de soi est total, sans calcul. Il semble que le rôle du linceul blanc soit d’une part de cacher la monstruosité de l’acte en ménageant la pureté de l’enfant, tout en symbolisant d’autre part, la pureté de l’âme emprisonnée dans ce corps d’oiseau, car il s’agit bien ici d’une métamorphose subie et non choisie.
Les épreuves
En se familiarisant avec les contes, on remarque que les épreuves dévolues aux héros diffèrent des épreuves dévolues aux héroïnes, véritables marqueurs sociaux-culturels trahissant les rôles futurs attendus pour chacun des genres.
À L’instar de Ève, pour l’héroïne du conte l’épreuve consiste à ne pas franchir, sous peine de catastrophes et des pires maux, un interdit qui n’aura de cesse bien sûr de la tenter. La liste de telles héroïnes est longue, on rappellera simplement « Le Petit Chaperon Rouge » qui ne doit pas quitter le chemin, l’épouse de « Barbe Bleue » qui ne doit pas utiliser la clé qu’on a eu le vice de lui confier, la fiancée du « Serpent languedocien » qui doit veiller à ce que personne ne touche à sa peau pendant son sommeil. Ici, notre héroïne ne doit jamais essayer de voir l’apparence de son époux. Comme dans « La Belle et la Bête », la Bête n’est bête que pour mettre à l’épreuve la Belle et vérifier sa capacité d’aimer vraiment. Où se situe cet amour ? Est-il intéressé, superficiel, attaché aux sens (attirance pour la beauté visible), ou capable de lire une humanité plus profonde ? Ou, dans un registre spirituel, cet amour est-il pur Amour Universel qui permettra l’éveil de l’âme errante ?
Dès le départ, l’épreuve est donc double : donner son amour à un être totalement inconnu et résister à une tentation bien naturelle de savoir à qui on a à faire. Pour ces héroïnes déjà citées, il s’agit plus généralement donc d’éprouver la chasteté de leur âme par la résistance à leurs sens (voir l’époux toucher une partie de son corps), doublée de la résistance au désir de savoir (connaître les secrets cachés comme dans Barbe Bleue, ou découvrir la forêt que le chemin ne laisse voir dans le Petit Chaperon Rouge). Résister à la curiosité de savoir, du Savoir, nous montre bien ces héroïnes comme les dignes héritières de Ève.
La curiosité, était-elle, est-elle encore aujourd’hui un défaut considéré comme typiquement féminin ? Si oui, il serait intéressant alors de se demander pour quelles raisons ?
Question de curieuse, sans vouloir jouer les héroïnes, comment peut-on craindre et aimer à la fois ? « Pourtant, la reine craignait et aimait le Roi des Corbeaux, parce qu’il était fort et hardi. »
Nous avons là un magnifique poncif du rôle attendu de l’épouse dans le mariage !
La chute
C’est la veille de la fin de l’épreuve que chute l’héroïne succombant alors à la tentation si longtemps repoussée. Belle leçon pour nous rappeler que rien n’est jamais acquis, aussi avancé que l ‘on puisse être sur le chemin christique, notre nature mondaine reste présente et dangereuse, toujours prête à nous faire chuter et à compromettre notre salut.
L’échec demande alors une nouvelle et dernière épreuve. Celle-ci nous renvoie au célèbre mythe de l’homme enchaîné, ou mythe de Prométhée.
Le Titan ayant volé l’étincelle divine à la roue du char du soleil de Zeus pour l’offrir aux humains, est alors puni de manière cruelle : enchaîné sur le Caucase, un vautour lui dévore le foie qui repousse chaque jour. L’analyse d’Eschyle[5]nous dévoile le sens profond de ce mythe dans le double problème :
On ne peut rien contre le Destin, malgré tout son Savoir.
Qu’a-t-on le droit de savoir, sans que ce soit un privilège, et sans qu’on en reçoive un châtiment ?
La parabole sibylline de la lavandière, nous est alors éclairée : « Les conseils ne servent à rien, et ce qui doit arriver ne manque jamais. »
La philosophe, Simone Weil[6] voit, quant à elle, dans l’histoire de Prométhée enchaîné comme la réfraction dans l’éternité de la passion du Christ. Prométhée est l’agneau égorgé depuis la fondation du monde.
Les lieux où se déroule le conte
L’homme vert et ses filles habitaient à la lisière du bois de Ramier. Le bois ici est protecteur, symbole d’une situation heureuse paradisiaque, comme dans tout début d’histoire avant l’événement perturbateur qui va mettre en danger cette situation initiale.
La reine doit quitter sa forêt protectrice pour aller vivre dans « le pays du froid, le pays de la glace, où il n’y a ni arbre ni verdure ». Le contraste est saisissant entre la douceur forestière et la rudesse suggérée du pays du « Nord ». « La montagne haute et sans neige » privée de couleurs, où le noir et la durée dominent ne font qu’ajouter à l’inquiétude face à l’inconnu. Dans ce décor plutôt hostile, le château luxueux et merveilleux, pourtant château-prison apparaît alors comme un refuge protecteur pour l’héroïne, vouée désormais à une grande solitude, loin des siens (cf. « La Belle et la Bête » et « conte languedocien du Serpent »).
Après la chute les lieux traversés prennent une tout autre dimension. L’épreuve bien plus difficile encore se déroule dans un autre monde, où plutôt trois autres mondes imaginaires connotés d’une forte valeur spirituelle, voire mystique. Le cheminement à travers le pays du jour, puis à travers le pays sans nuit ni jour, et enfin à travers le pays de la nuit, représente trois longues années d’errance spirituelle, d’aveuglement, de doute, de cécité ; c’est là une bien belle et poétique image du cheminement cathare ! Le dernier lieu du conte enfin se trouve être, encore une fois (cf. « L’homme voilé »), « la mer grande ». La traversée de cette mer, peut symboliser alors une étape finale permettant l’accession à une pureté totale.
L’objet magique
C’est seulement après cette longue errance que la reine parvient alors au bout de sa quête. Elle trouve enfin l’objet magique essentiel pour rompre le mauvais sort et libérer son époux : « l’herbe bleue, l’herbe qui chante nuit et jour, l’herbe qui brise le fer ». Cet objet magique nous rappelle bien sûr « la Fleur Dorée, la fleur de baume, la fleur qui chante comme un rossignol », cet autre objet magique essentiel, lui pour libérer tout un peuple de la peste. Ces objets magiques empreints de poésie qui permettent la libération d’un être (ou d’un peuple) sont l’allégorie, me semble-t-il, de l’éveil de l’âme spirituelle.
Pourtant, les épreuves ne sont pas encore toutes derrière la reine : « Elle repartit dans la nuit, marchant pieds nus parmi les épines. Elle marcha longtemps, longtemps. Enfin, la nuit finit, et le soleil se leva ». Encore donc un long temps à marcher, comme un chemin de croix avant le dénouement. Si ce chemin de douleur est fort d’une connotation judéo-chrétienne, nous pouvons, de manière plus cathare, y voir le cheminement du croyant qui a connu l’éveil et qui maintenant doit se dépouiller progressivement des différentes couches mondaines de sa tunique de chair en faisant siens les préceptes de la Règle de Justice et de Vérité.
Le temps, marqueur du spirituel et du mondain
Le temps, dans « la légende de l’herbe bleue », a exactement les mêmes valeurs contextuelles que dans celui de « L’homme voilé ». Comme on avait déjà pu le remarquer à la lecture de ce conte, le temps se trouve comprimé ou élargi à l’envi, selon qu’il qualifie la vie dans le monde ou la vie intérieure.
Les mêmes tournures de phrases sont utilisées pour désigner le temps des épreuves vécues dans la solitude, qui est en fait le temps de l’introspection et de la quête spirituelle : « Elle marcha longtemps, longtemps ». Le temps s’étire à l’infini, s’approche de l’éternité, image métaphorique de la spiritualité, alors qu’il se comprime et devient mesurable, comptabilisable, lorsqu’il désigne les actions dans le monde, et les crédits, profits et pertes qui en découlent, image métaphorique de la finitude matérielle. Et tout comme dans « L’homme voilé » encore, dans ce temps « compté », le mesurable est exprimé par les mêmes nombres symboliques. Le 3 et le 7 sont ceux qui reviennent le plus souvent : la traversée des autres mondes durera en tout trois ans, trois jours de marche séparent les autres mondes les uns des autres, la traversée de la mer grande dure, sept jours et sept nuits, et enfin sept mille navires viennent chercher le peuple du roi. Ce magnifique conte nous emmène dans un monde merveilleux, insoupçonné et apparemment lointain mais qui pourtant s’attache à notre âme pour longtemps…
[1] La classification Aarne-Thompson (ou A.T.U), devenue internationale, distingue 4 grandes catégories dans les 2340 contes-types répertoriés, divisées elles-mêmes ensuite en sous-catégories.
[2] Apulée (vers 125- après 170) écrivain, orateur et philosophe médio-platonicien, auteur de « Métamorphoses ou L’Âne d’or »
[3] Jacques E. Merceron, professeur de littérature française médiévale, membre du Centre d’Études Médiévales, « Nouvelles Mythologies Comparées ».
[4] G. S. Nourry-Namur. Agrégée de lettres classiques : « Le conte, nature et métamorphose » in revue de mythologie, hors-série n°10.
[5] Eschyle (-525, -456) : Le plus ancien des trois grands tragiques grecs, auteur d’environ 110 pièces dont 7 seulement nous ont été transmises. « Prométhée enchaîné » est une pièce supposée être de lui, mais cette attribution reste douteuse.
[6] Simone Weil (1909-1943) « pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu » et « Intuitions pré-chrétiennes ».
Chantal Benne le 05/07/2022.