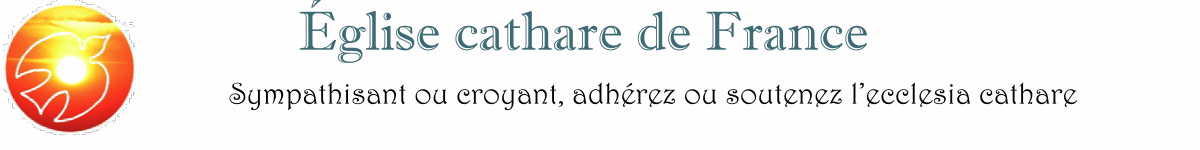Pratiquer, enseigner, critiquer
Le monde moderne n’a rien à envier au Moyen Âge ou à l’Antiquité en matière de brutalité, de violence, de mépris et de bassesse humaine.
Au contraire, je trouve que, sous des dehors apparemment plus policés, ces tares sont en constante progression, confirmant ainsi la vision cathare selon laquelle le monde s’appauvrit en Bien et se « purifie » dans le Mal.
Dans le respect de la ligne directrice de cette chronique de la pensée cathare adaptée à notre époque, je voudrais traiter des deux sœurs jumelles dans le Mal que sont la vanité et l’intolérance. Sachant à quel point elles me taraudent régulièrement et tous les efforts que je dois fournir pour les contrer, avec un succès dont je vous laisse juges, je me sens plutôt bien placé pour les étudier, en quelque sorte.
Agir, enseigner ou critiquer ?
George Bernard Shaw avait livré une de ses réflexions incisives sur le sujet sous la forme suivante : Celui qui peut, agit, celui qui ne peut pas, enseigne.
Un anonyme que je n’ai pu retrouver avait précisé : Celui qui ne sait pas écrire enseigne et s’il ne sait pas enseigner, il devient critique.
Cette maxime résume bien le monde. Celui qui agit prend le risque de se tromper et de le montrer clairement, et souvent durablement. Sa certitude devient donc une erreur et lui-même régresse dans l’échelle des compétences humaines. Celui qui enseigne évite de se mettre directement en danger et ne risque que la moquerie s’il est pris en flagrant délit de faute dans son enseignement. La honte est la même, mais son champ d’action est restreint. Par contre, celui qui critique ne risque pas grand-chose. S’il s’avère que sa critique est fausse, il s’en tire le plus souvent en feignant de ne pas avoir critiqué ou s’il ne peut le cacher en prétendant avoir été mal compris. Au pire, il se fait oublier quelque temps avant de recommencer de plus belle. Surtout, personne ne saurait s’aviser de lui demander de prouver qu’il a raison en réussissant là où ceux qu’ils critiquent auraient peut-être échoué.
C’est pour cela que l’on remarque que plus il y a de risque à agir, plus on trouve de critiques.
J’en veux pour exemple un champ d’action très à la mode en ce moment, la politique. Le politique doit réussir quand tout le monde à échoué, quand les conditions extérieures rendent la réussite impossible et s’il échoue il est responsable, alors que s’il réussit c’est forcément grâce à de bonnes circonstances et non en raison de ses talents.
Certes, on trouve à foison chez les politiques des vaniteux et des intolérants. Ils le sont tous au moins autant que le reste de la population. Par contre, ceux qui franchissent le pas de l’action prouvent qu’ils sont les moins malins — dans tous les sens du terme — car ils se mettent immédiatement dans le camp des victimes dont les autres vont se repaître. Cela me rappelle un film si terrible que je n’ai jamais pu en regarder la moindre rediffusion : Ridicule, de Patrice Leconte, avec Charles Berling. Dans ce film, un petit noble de province monte à Paris pour proposer au roi un projet de nature à améliorer sensiblement la vie des paysans de sa région. Mais, il se trouve pris dans le piège des pratiques courtisanes nécessaires pour approcher les décideurs. Or, la principale règle de la cour consiste à tourner quiconque en ridicule sur quelque sujet que ce soit afin de défaire les meilleures réputations et de monter en épingle les pires vices. Cela provoquera sa perte et l’échec de sa mission.
Aujourd’hui, les courtisans sont en général les journalistes et quelques politiques aigris qui prennent un malin plaisir à détruire toutes les tentatives susceptibles d’être bénéfiques avant qu’elles aient eu le temps de produire des effets pour mieux regretter qu’elles n’aient été menées à bien dès que leur mort fœtale est constatée. Mais, ces mêmes critiques se gardent bien de se lancer en politique pour montrer que leurs critiques étaient fondées et qu’ils sont capables de réussir là où leurs victimes ont échoué, souvent par leur faute.
Certes, on ne peut agir efficacement sans avoir pris la peine d’apprendre, car alors on va à l’échec et ses conséquences peuvent impacter d’autres que soi. Mais, si l’on veut critiquer, il faut alors proposer de mettre en œuvre ce que l’on pense être la meilleure alternative. La critique sans action est un poison destructeur et n’apporte aucune capacité d’apprentissage et d’évolution. De même, enseigner sans avoir pratiqué est un non-sens. Je me souviens avoir suivi un enseignement de secourisme et avoir désiré devenir enseignant en la matière. Je me suis donc inscrit à la formation de moniteur national. Mais dès que j’ai commencé ma formation, j’ai compris l’inanité qu’il y avait à vouloir enseigner ce que l’on n’a pas pratiqué. Aussi me suis-je immédiatement inscrit dans les équipes de secours de la Croix-Rouge française afin de vérifier sur le terrain la validité de ce que je prétendais enseigner. Pour autant, tout bon praticien n’est pas forcément un bon enseignant et il n’est pas nécessaire d’être le meilleur praticien pour être le meilleur enseignant. Ces deux disciplines ayant leurs propres particularités et exigences font que l’excellence n’est pas forcément superposable entre elles.
La vanité et l’intolérance : un cercle vicieux
Beaumarchais, dans sa pièce sulfureuse, Figaro, prête ces paroles à son personnage :
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ; il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. »
Pour autant, avant de s’autoriser à blâmer qui que ce soit, il convient de s’assurer que l’on n’est pas soi-même accessible à la critique justifiée. Cela nous renvoie à la parabole de la femme adultère. Qui de nous se croit sans péchés et s’autorise à jeter la première pierre ?
Car la question la plus profonde est là. Notre incarnation nous met dans un tel état de dépendance vis-à-vis du monde qu’il nous donne à voir pour valable ce qui n’a d’autre but que d’empêcher l’émergence de l’esprit qui est maintenu contraint dans notre corps de boue. Et pour y parvenir, le plus efficace est de nous donner à croire que nous ne sommes pas prisonniers et que nous sommes même un individu au-dessus de la moyenne qui a donc le droit de juger les autres. Cette disposition intellectuelle est la vanité.
Cette vanité est, avec la sensualité, le plus puissant levier utilisé par le monde pour nous empêcher de nous éveiller à notre état spirituel.
La vanité flatte notre égo, nous fait croire capable de grandes choses ou magnifie à l’excès les petites choses que nous entreprenons. Or, l’égo est l’opposé de la Bienveillance ; il veille à notre seul intérêt, y compris au détriment de tous les autres, qu’ils soient meilleurs et plus utiles au groupe que nous.
Du coup, la vanité va nous pousser à développer une autre arme antisociale : l’intolérance.
L’intolérance est ce qui nous permet de rejeter les autres pour diverses raisons. Ceux qui en savent plus que nous sont des fats, même si nous passons notre temps à monter en épingle les rares savoirs dont nous disposons. Ceux qui ont ce que nous envions sont des profiteurs, des vaniteux, voire des voleurs alors que si nous avions ce que nous leur envions, ce serait par simple justice sociale, tant nous méritons mieux que ce que nous avons. Et cela n’a aucune limite. Plus nous sommes privilégiés par la vie et plus nous déplaçons le critère de notre nécessité vers le haut. Le smicard rêve d’avoir le double pour vivre mieux, mais celui qui a atteint ce niveau espéré rêve lui aussi d’augmenter fortement ses revenus, tant il est convaincu d’en avoir un besoin vital. Et les plus riches, les plus reconnus n’en ont pas assez, car perdre leur superflu leur semble être une régression sociale insupportable.
Donc, nous rejetons ceux qui diffèrent ou qui nous rappellent que le partage permet de réduire la misère et l’intolérance. Et notre égo justifie tout, y compris de rejeter ceux dont la souffrance, qui est parfois due à notre mode de vie, nous rappelle combien nous sommes loin de la Bienveillance.
La religion et la philosophie
La philosophie est en constante dégradation : pratiquée intellectuellement et au quotidien chez les Grecs, les Romains en ont fait une nouvelle présentation (néo-) en se contentant d’enseigner ce que faisaient les Grecs. Les catholiques ont poussé cette approche scolastique au seuil de la critique en rejetant toute philosophie qui ne validait pas leurs thèses. Aujourd’hui, on appelle philosophie ce qui n’en est pas réellement et les enseignants sont plus proches de la sophistique que critiquait Socrate (Protagoras) à juste titre.
En matière de religion chrétienne, on peut constater une même évolution. Initialement, voie de vie en vue du salut, elle fut appauvrie afin de correspondre aux exigences impériales et devenir ainsi dominante sous sa forme judéo-chrétienne. Ensuite, elle devint une approche intellectuelle détachée de la pratique, car en l’imposant aux nouveau-nés le christianisme a perdu son sens essentiel : le choix intime d’une vie spirituelle. En outre, la séparation des populations entre ceux qui se « sacrifient » dans la pratique religieuse — destinés à remplacer les martyrs disparus avec l’officialisation de l’Église —, et ceux qui leur confient leur salut personnel en échange d’une prise en charge de la vie quotidienne (denier, du culte, etc.) a créé une différence de statut qui n’existait pas à l’origine. Aujourd’hui, elle est devenue une sorte d’auberge espagnole où chacun s’arroge une appartenance religieuse, voire un statut ou un titre, tout en rejetant ce qui ne lui convient pas, quand bien même cela constitue la colonne vertébrale de ladite religion.
Or, le principe essentiel de la religion et de la philosophie est de nous rappeler qu’il ne faut pas contenter de vivre comme les animaux évolués que nous sommes, mais que nous devons rechercher en nous ce qui peut nous élever au-dessus de la mêlée. Or, toute nouvelle voie à suivre oblige à acquérir un savoir adapté, c’est-à-dire à étudier sérieusement et profondément le sujet que l’on prétend maîtriser. La philosophie est l’école de la modestie et la religion, celle de l’humilité. « Tout ce que je sais est que je ne sais rien » disait Socrate. C’est pourquoi la résurgence du catharisme crée un choc après sept siècles d’oubli. En effet, cette voie chrétienne est la preuve que l’on peut — et je dirais même que l’on doit —, être chrétien en vivant dans la règle de l’Église au quotidien. Pourtant, s’il est évident que chacun ne peut pas vivre en chrétien, tant la prégnance mondaine pèse sur nous, il faut cependant y tendre sur les principes essentiels, comme la non-violence, l’humilité, la tolérance, l’honnêteté, etc. En effet, s’extraire de ces bases développe des comportements comme l’intolérance et la vanité qui éloignent de la part spirituelle qu’il nous faut éveiller en nous et qui installent un cercle vicieux extrêmement difficile à rompre.
Comment être un « honnête homme ? »
Ce terme, issu du siècle des Lumières, désigne celui qui vit dans le monde en maintenant au mieux un comportement compatible avec ses aspirations personnelles.
Mais il faut différencier les gens selon leurs convictions morales, philosophiques, voire religieuses. Nous savons qu’elles sont très variables selon les cultures et les pays et qu’elles peuvent aussi être influencées par les idées politiques et religieuses, notamment. L’anthropophagie est universellement rejetée, sauf dans quelques tribus indigènes, on y voit une façon de s’approprier le courage de l’ennemi.
Sur le plan moral, ce sont donc souvent les règles sociales qui définissent le cadre à respecter. Elles dépassent le cadre des lois et règlements, car ces derniers ont une portée générale alors que la morale est individuelle, c’est-à-dire qu’elle peut nuancer et dépasser les lois. Si l’on n’a que la morale comme guide, on peut certes vivre honnêtement, mais dans un cadre restreint qui se limite à un monde où elle s’applique. Il suffit parfois de passer une frontière pour que notre morale devienne inapplicable ou illégale.
Sur le plan philosophique, ce sont des règles intellectuelles qui viennent au secours ou à l’encontre de la morale. Ces règles émanent d’une construction logique et cohérente qui place l’homme au-dessus du monde quotidien et le pousse à réfléchir d’une façon globale ayant pour objet le bien de l’homme en ce monde. La philosophie veut diriger l’homme comme la politique veut diriger la société. Elle cherche à réduire les impulsions au profit de la réflexion, mais en conservant cependant un cadre qui, par définition, est limité par des bornes.
Sur le plan spirituel, ce sont des règles doctrinales qui viennent remplacer les bornes légales et intellectuelles. Parfois, elles sont en accord avec ces dernières, parfois elles sont plus libérales et parfois elles sont plus strictes. Le but de ces règles est de permettre à l’homme de s’approcher, autant que faire se peut, de l’idéal qu’il vise. Cela met donc cet idéal au-dessus des lois du monde selon que la religion de référence considère le monde comme issu de la transcendance visée, inférieur en qualité à cette transcendance ou, parfois, contraire aux objectifs de cette transcendance.
L’homme peut donc vivre au mieux selon ses aspirations qu’elles soient simplement morales ou qu’elles y adjoignent des considérations intellectuelles, voire religieuses. Et c’est ce que nous devons viser tout en nous rappelant que personne d’autre que nous ne peut réaliser cet objectif. Celui qui critique vit hors de sa réalité ; celui qui enseigne admet ne pas pouvoir l’atteindre malgré ses espoirs et celui qui agit est le seul qui soit capable de mettre en adéquation ce qu’il croit et ce qu’il est. Mais celui qui agit dans l’humilité et la bienveillance doit les conserver quand il enseigne ce qu’il fait et s’il est amené à critiquer des arguments insuffisamment fondés, parce qu’il a pris soin de rendre les siens aussi puissants que possible.
Guilhem de Carcassonne