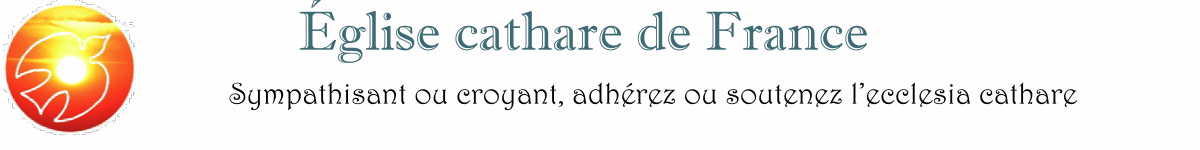Le détachement comme abandon de soi
Si l’on devait rechercher un trait commun — un fil rouge en quelque sorte — qui traverse toutes les espèces animales et qui les caractérise sur le plan psychique, il me semble que ce serait vraisemblablement la conscience de soi.
De la conscience de soi à l’instinct de survie
La conscience de soi, c’est-à-dire la prise en compte de la spécifique organique que représente l’entité biologique qui me constitue. Certes, entre la conscience de soi extrêmement ténue que l’on trouve chez les insectes sociaux, dévoués corps et âme à leur communauté — parfois jusqu’à se sacrifier sans espoir de bénéfice personnel — et celle de l’humain, transcendée à l’extrême dans un égocentrisme forcené, il y a un monde.
Cependant, le mécanisme initial est le même. La conscience de soi permet de comprendre que l’on est différent de l’autre, y compris de l’autre dont les caractéristiques sont si proches des nôtres que l’on pourrait s’y tromper. Même le jumeau parfait dispose d’une conscience de soi personnelle. La conscience de soi est instinctive puisqu’on la trouve partout dans le règne animal. Elle n’est donc pas partie prenante de l’esprit.
La conscience de soi est en fait, à l’opposé, un élément prégnant de la nature mondaine, car en affirmant l’individualité, elle construit les fondements protecteurs de l’individu.
En effet, la conscience de soi va donner naissance à la valorisation de soi, qui va justifier la protection de soi et aboutir, in fine, à la volonté de survie.
Or, la volonté de survie, aussi appelé instinct de survie, est typique du règne animal et tous les efforts de l’animal le plus frustre jusqu’au plus évolué — que nous croyons être l’homme — n’ont d’autre but que de servir cet instinct, y compris au-delà de la vie charnelle par le biais de la procréation qui est vécue comme une forme d’immortalité.
De l’animal à l’homme primitif
Ainsi constitué, nous comprenons pourquoi l’animal peut agir de façon parfois illogique, car sa logique étant dictée par son instinct de survie, sous tendu par la conviction de l’importance de cette survie, il peut arriver qu’il favorise ce qui lui paraît relever de la survie individuelle à court terme, au risque de provoquer une destruction massive dont au final il va être lui-même victime.
Chez l’homme c’est encore plus compliqué. Face à un risque vital identifié et s’il dispose du temps d’adaptation nécessaire, l’homme va tenter d’associer d’autres hommes à sa démarche de survie afin d’améliorer les chances d’y parvenir. C’est ainsi que nous avons constitué les cellules familiales puisque nos petits étaient incapables de survivre avant plusieurs années d’élevage. Ensuite, nous avons réussi à surmonter l’égoïsme que générait la conscience de soi en associant plusieurs cellules familiales, puis plusieurs groupes ethniques, pour finir par constituer des sociétés humaines et même des civilisations.
Pour autant, que survienne un risque immédiat et important et l’individu reprend le dessus. Il est prêt à abandonner son contrat social au profit d’une démarche individualiste stricte. Les exemples sont nombreux de comportements instinctifs face à un risque vital immédiat, même quand cela ne servait qu’à retarder légèrement l’échéance fatale. Il est un exemple terrible qui me revient en mémoire. Quand les nazis gazaient leurs malheureuses victimes dans les chambres à gaz, on retrouvait ces dernières entassées, en un monticule de corps vaguement conique, car les plus forts avaient écrasé les plus faibles pour se rapprocher du plafond où l’air serait empoisonné en dernier.
Aussi horrible que cela paraisse et aussi forte que soi notre volonté de ne jamais céder à une telle pulsion, nous savons qu’elle n’est que l’expression de notre animalité profonde qui, sans une once de réflexion, va nous pousser à retarder autant que faire se peut une issue inéluctable.
Ce comportement est lié à l’attachement profond, atavique, génétique et instinctif à notre nature mondaine animale. Car ce monde et ce qu’il porte en lui a conscience d’un fait alarmant et anxiogène qui est la certitude de sa finitude.
Les créatures de ce monde savent qu’elles ont eu un début et qu’elles auront une fin.
Comment l’esprit contrarie la mondanité
Quand l’esprit commence à poindre sous l’animal, les choses peuvent changer selon l’importance de son émergence.
Je ne parle pas bien entendu de la simple différenciation d’espèce qui s’est effectuée lors du processus d’hominisation, car comme le décrit René Girard, ce processus n’est en fait que l’organisation d’une espèce animale qui, utilisant un outil supérieur aux autres : son cerveau, va réussir à se hisser en haut de la chaîne de puissance animale. Non, l’émergence de l’esprit est au contraire un processus par lequel un animal dominant et fier de sa supériorité, qui est peut-être même passé par un stade élevé de conviction de sa supériorité personnelle sur les autres membres de son espèce (bien que cela semble devoir gêner ce processus), finit par concevoir qu’une part de lui n’a rien à voir avec cette conviction de finitude.
En comprenant qu’une part de lui dépassera les barrières fixées en ce monde par la mort charnelle et la fin des temps, que tous les cycles vitaux biologiques, chimiques ou physiques donnent en exemple, il comprend qu’il porte en lui un élément extérieur à ce monde et que cet élément obéit à d’autres lois.
Naît alors un homme nouveau car je pense que cela ne s’observe pas dans le règne animal. Cet être nouveau, au fur et à mesure que croît cette compréhension et qu’il en saisit toute l’importance, va se détacher de ce qui lui semblait essentiel et qui devient de plus en plus futile à ses yeux enfin ouverts et va commencer une nouvelle vie.
Pourtant, l’être mondain persiste en lui et, obnubilé par ses impératifs de survie va tout tenter pour empêcher ce qui sera très vite compris comme contraire aux impératifs de l’instinct de survie.
S’il peut tolérer que, dans un monde ultra-protégé, l’on puisse ne pas toujours chercher à se mettre en avant, à ne pas toujours chercher à écraser la concurrence, il ne peut admettre ce qui pourrait constituer à terme un instrument susceptible de nuire gravement aux chances de survie. Cet être mondain est faible puisque dépourvu d’esprit, fragile puisque dépourvu de discernement, pitoyable puisque soumis à une règle qu’il ne comprend pas. C’est en cela qu’il doit être respecté.
Il est facile de comprendre combien le comportement de l’homme nouveau est à la fois incompréhensible et alarmant pour les hommes mondains qui l’entourent.
C’est bien pourquoi ces derniers vont chercher à valider leur propre mode de fonctionnement en s’opposant de façon progressivement violente à celui qui leur semble, non seulement mettre en danger sa propre survie, mais également faire courir un risque vital aux autre si son cas s’avérait contagieux. Et plus il semblera effectivement contaminer d’autres hommes, plus les mesures à prendre contre lui deviendront urgentes et radicales.
Finalement si j’emploie ces terminologies, vous l’aurez compris c’est qu’elles résonnent en moi à la lecture des textes bibliques. L’homme animal, celui qui accède au processus d’hominisation et qui va le pousser à son paroxysme, c’est l’Adam de la Bible. Initialement en harmonie non violente avec le reste de la sphère animale, il va s’en détacher et prendre sur elle un ascendant définitif. Il suffit de relire la Genèse pour le comprendre. L’homme nouveau apparaît lui dans le Nouveau Testament. Jésus le fait naître en apparaissant, à contrario de la nature et des attentes de ses contemporains juifs pour qui le Messie est un guerrier victorieux, comme un homme « mondainement » faible mais spirituellement supérieur. Paul évoquera longuement cet homme nouveau qu’il a vu grandir en lui depuis l’épisode de la route de Damas.
L’homme nouveau et le détachement de soi
Cet homme nouveau, l’homme spirituel donc, se caractérise par un détachement progressif des instincts primitifs les plus aboutis et donc par une déconnexion avec cette conscience de soi qui caractérise l’homme animal.
Tout ce qui faisait considérer à ce dernier qu’il était un élément primordial et que sa survie était infiniment préférable à celle de tout autre élément constitutif de son environnement, devient futile pour l’homme nouveau. Au contraire, il ne se voit plus comme une unité individuelle mais comme une portion infime d’un grand tout tourné vers un créateur absolu dont il se considère identique sur le plan de la substance mais dont il se sait inférieur sur le plan de la nature.
En fait, pour lui, l’enjeu vient de changer de camp. Sa prise de conscience lui ouvre des horizons nouveaux et lui démontre la nécessité de changer profondément. C’est un peu comme ces enfants qui se disputent âprement un jouet. Tout à coup, l’un d’entre-eux aperçoit quelque chose qui le fascine et abandonne ce qu’il défendait bec et ongle l’instant précédent. L’autre, un instant fier de sa victoire, prend conscience qu’elle n’est peut-être que l’annonce d’une défaite plus grande. Selon le principe de mimésis d’appropriation si clairement exprimé par René Girard, ce n’est pas forcément la propriété qui satisfait la conscience de soi, c’est la possession du désir de l’autre. Plus que de vouloir ce que l’autre possède, je souhaite posséder ce qu’il désire et ne peut posséder.
L’homme nouveau se détache de ce monde parce qu’il entrevoit la création divine. Mais l’homme primitif lui ne la voit pas. Ce qu’il voit c’est le désir de l’autre pour quelque chose qui justifie de lui abandonner les biens de ce monde. Forcément cela veut dire que les biens convoités (car l’homme primitif ne peut raisonner qu’en terme de possession) sont d’une qualité supérieure à ceux dont il doit se contenter.
Dès lors, il n’y a que deux possibilités. Vu qu’il ignore être capable lui aussi d’accéder à cet espoir, il ne peut que renoncer et accepter d’être moins bien loti que l’autre, soit empêcher l’autre d’atteindre son objectif. Ce que je ne peux avoir que personne d’autre ne l’ait sera une consolation à défaut d’être une satisfaction. L’apaisement de cette frustration explique la plupart des conflits que connaît l’humanité.
Des événements récents survenus ici viennent illustrer parfaitement cette analyse. L’instinct animal visant à priver l’autre d’un bien que l’on ne peut obtenir pousse à des extrémités qui peuvent conduire à la destruction du bien, qui était devenu inaccessible, et que l’on considérait pourtant comme indispensable. Mieux vaut ne rien avoir que de ne pas tout avoir. Même une concession de partage qui ne s’appuierait pas sur l’écrasement de celui qui m’a un jour évincé est inacceptable. Et quiconque n’épouse pas absolument ma cause est un ennemi.
L’envol du papillon
Quand on s’éveille à la découverte de l’esprit, petit à petit on prend de la hauteur et on comprend le comportement de ceux qui n’ont pas encore atteint ce stade.
Plus le détachement de soi s’amplifie et plus on se souvient que l’autre n’est pas maître de son comportement et que c’est son animalité et son instinct de survie qui le guide dans ses comportements. Cet être faible, fragile et pitoyable, comme je le disais plus haut, nous devons le respecter et le protéger. Qu’il s’agisse de notre corps mondain ou d’un autre dont l’esprit encore embrumé laisse sa mondanité diriger ses actes. Et quand bien même il prendrait cette bienveillance pour une faiblesse et en abuserait jusqu’à l’extrême, nous devrions nous rappeler que ce n’est que l’animal faible, fragile et pitoyable qui agit en lui. Voilà le vrai sens du « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » prononcé par Jésus, par Étienne et par bien des martyrs au fil des siècles.
En nous détachant de notre conscience mondaine nous abandonnons notre mondanité à sa finitude, sans regret mais sans chercher à la hâter non plus.
L’abandon de soi est le respect des cycles. Comme la chenille abandonne sa chrysalide pour devenir un papillon, l’homme nouveau abandonne sa conscience de soi pour se rapprocher de son état spirituel. Et quand cet abandon sera confirmé par la perte de son état mondain, il pourra s’envoler tel un papillon vers sa destiné éternelle.